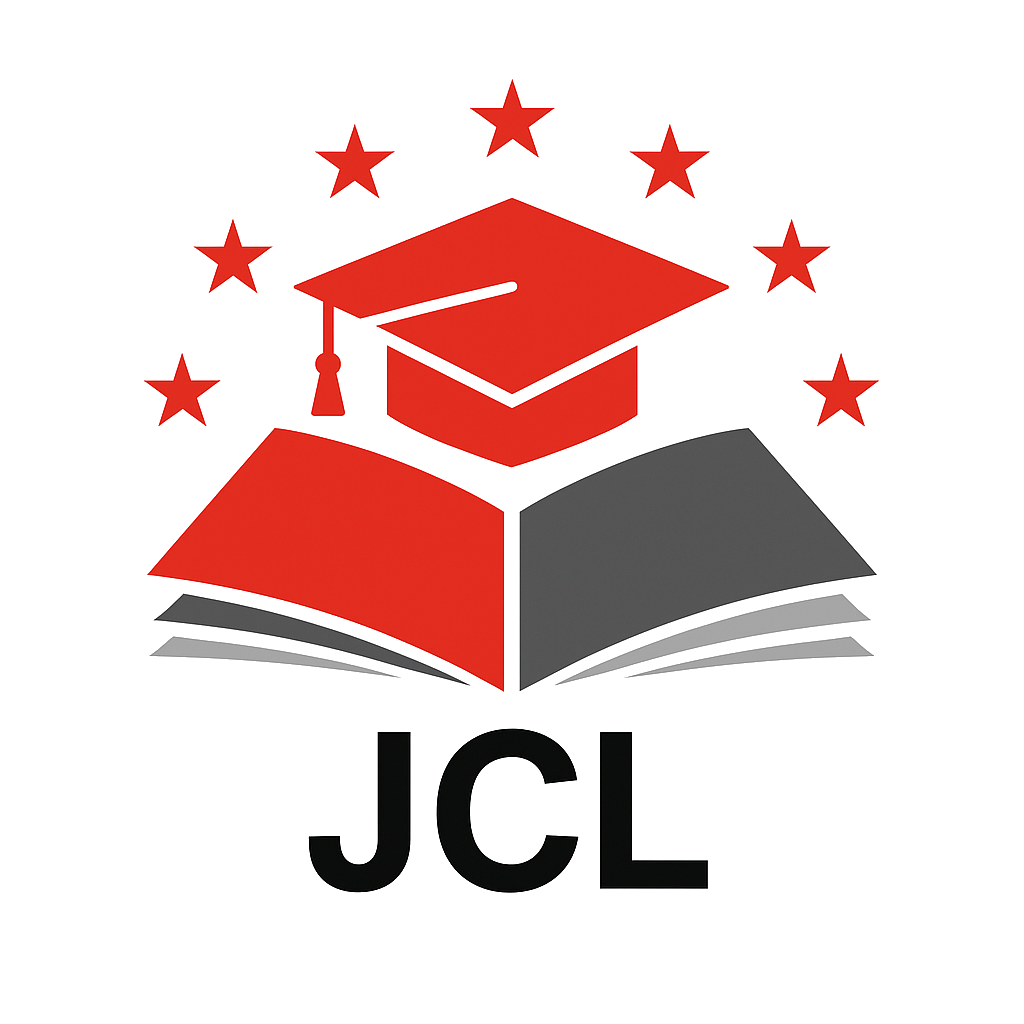Précontractuel
(Rupture des pourparlers - Obligation d'information - Devoir de confidentialité)
Précontractuel
(Rupture des pourparlers - Obligation d'information - Devoir de confidentialité)
- PREMIERE PARTIE - LA RUPTURE DES POURPARLERS
- 1. – Les principes posés par l’article 1112 du Code civil concernant les pourparlers
- 2. – La détermination du caractère fautif de la rupture des pourparlers
- 3. – La détermination du préjudice indemnisable
- DEUXIEME PARTIE - OBLIGATION PRECONTRATUELLE D'INFORMATION
- 1. – Les principes posés par l’article 1112-1 du Code civil concernant l’obligation précontractuelle d’information.
- 2. – L’étendue et l’intensité de cette obligation
-
3. – Le droit d’information suppose la réunion de 3 conditions
- 3.1 – Première condition : une importance déterminante de l’information pour le débiteur (acheteur)
- 3.2 – Deuxième condition : la connaissance effective de l’information pour le créancier (vendeur).
- 3.3 – Troisième condition : l’ignorance légitime de l’information par le débiteur (acheteur).
- 3.4 – Un arrêt de la Cour de cassation illustrant cette obligation
- 4. – Preuve pour le débiteur et le créancier de l’obligation d’information.
- 5. – Sanctions du manquement au devoir d’information.
- 6. – Caractère d’ordre public de l’obligation d’information
- TROISIEME PARTIE : DEVOIR DE CONFIDENTIALITE
- 1. – Le devoir de confidentialité défini par l’article 1112-2 du Code civil
- 2. – Commentaires
PREMIERE PARTIE - LA RUPTURE DES POURPARLERS
1. – Les principes posés par l’article 1112 du Code civil concernant les pourparlers
Article 1112 du Code civil :
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
Il est fréquent, avant de parvenir à un accord, que les parties à un contrat discutent entre elles pendant un certain temps des conditions de leurs engagements réciproques : c’est ce qu’on appelle la période des pourparlers.
Durant cette période, par hypothèse, les parties ne sont encore pas contractuellement engagées l’une envers l’autre. Le principe est donc qu’à tout moment, elles peuvent, l’une comme l’autre, décider de ne pas poursuivre les pourparlers et reprendre ainsi leur entière liberté de négociation, avec notamment un autre partenaire. Bien évidemment, comme tout principe qui se respecte, celui-ci connaît une exception importante.
La liberté de négociation ne doit en effet pas dégénérer en abus de droit sous peine pour le partenaire malhonnête d’engager sa responsabilité.
La responsabilité de l’auteur de la rupture fautive est de nature délictuelle, puisque l’on se situe dans la période précontractuelle et qu’aucun contrat n’a pu être conclu du fait de la rupture des pourparlers. Le fondement de la responsabilité est donc l’article 1240 (anc. art. 1382).
2. – La détermination du caractère fautif de la rupture des pourparlers
Il convient de rappeler que chaque partie peut rompre les négociations, sauf le cas d’un contrat de pourparlers délimitant les conditions de rupture, si elle estime ne pas avoir intérêt à conclure le contrat projeté.
Elle risque néanmoins d’être condamnée à indemniser son partenaire du préjudice subi par lui si sa décision est intempestive ou abusive.
2.1 – Cas de ruptures jugées fautives
Les juridictions ont souvent été appelées à se prononcer sur le caractère fautif d’une rupture.
Le plus souvent, l’abus est retenu lorsque la rupture :
- est survenue après des pourparlers longs, complexes, extrêmement avancés et ayant occasionné d’importants frais justifiés par l’appel à des spécialistes aux fins d’établir des études ou des actes préparatoires,
- est intervenue la veille de la signature de la promesse alors que les pourparlers étaient très avancés,
- est intervenue quatre ans après le début des pourparlers pendant lesquels l’auteur de la rupture avait laissé espérer à son partenaire un accord définitif qui avait été abandonné, non pour des considérations mettant en cause la qualité du produit objet de la négociation, mais pour des raisons internes au groupe auquel il appartenait,
- a été décidée par l’initiateur d’un projet qui a abandonné celui-ci, sans motifs et sans avis au partenaire, alors qu’il lui avait soumis un projet d’accord industriel, que le partenaire l’avait accepté sans réserve et que les services techniques de chacune des deux parties poursuivaient la mise au point du projet commun.
L’abus peut également résulter de la mauvaise foi de l’auteur de la rupture qui, sans motif réel et sérieux, a sciemment maintenu son partenaire dans la croyance d’une signature définitive de l’accord, l’intention de nuire n’étant alors nullement requise.
2.2 – Rupture non fautive
Inversement, la jurisprudence refuse de considérer comme abusive une rupture qui intervient alors que les pourparlers n’avaient pas atteint un stade suffisamment avancé. En pareille hypothèse ce n’est pas la durée des pourparlers qui est retenue (cette dernière pouvant être également longue) mais l’absence d’accord des parties sur l’une des conditions essentielles du contrat tel que le prix.
Ainsi, n’ont pas été jugées fautives :
- la rupture par une partie à un moment où les négociations en étaient encore à évaluer les risques et chances du contrat envisagé empêchant ainsi les professionnels avertis de prétendre que les négociations étaient sur le point d’aboutir,
- la rupture des négociations engagées de longue date et pour lesquelles des sommes importantes ont été investies, dès lors que ces pourparlers n’avaient pas encore atteint un stade avancé puisque les conditions de livraison et de prix du matériel restaient à définir et que par conséquent les frais de cette opération ne pouvaient être imputés à l’auteur de la rupture mais correspondaient à un risque commercial normal,
- lorsque la rupture est intervenue sans surprise, son auteur ayant toujours fait connaître à l’autre partie la condition à laquelle il subordonnait son accord.
3. – La détermination du préjudice indemnisable
Lorsque la juridiction compétente a retenu le caractère intempestif ou abusif de la rupture des pourparlers, il y a lieu de statuer sur les dépenses susceptibles d’ouvrir droit à remboursement ainsi que sur les préjudices indemnisables.
3.1 – Le préjudice résultant des dépenses effectuées dans le cadre des pourparlers
Bien souvent, la phase des pourparlers engendre certaines dépenses ayant trait à l’étude de la faisabilité du projet objet des pourparlers ou bien encore au commencement d’exécution de la convention.
Pareilles dépenses exposées en vain ouvrent droit à remboursement telles que :
- les dépenses et dérangements,
- les frais de voyage,
- les frais d’études préliminaires comprenant, le cas échéant, le recours à des spécialistes,
- les frais d’aménagement d’un immeuble en vue de l’utilisation projetée, telle la transformation d’un local commercial.
Il est à noter également que les actes accomplis pendant les pourparlers en vue de la conclusion du contrat projeté peuvent donner lieu à restitution ; ainsi, le droit au bail consenti dans la perspective de la constitution d’une société doit être « restitué » en valeur par le locataire à qui il avait été accordé en vue d’une exploitation et avec lequel le bailleur avait formé le projet avorté de créer une société.
Enfin, il est également possible de revendiquer l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte au crédit et l’altération de l’image auprès d’autres partenaires par contrecoup d’une rupture qui fait douter du sérieux du négociateur délaissé.
3.2 – La perte d’une chance ne constitue pas un préjudice indemnisable
Le préjudice réparable en cas de rupture abusive des pourparlers se limite à la perte subie et exclut le gain espéré de la conclusion du contrat (article 1112, alinéa 2).
La « perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ».
DEUXIEME PARTIE - OBLIGATION PRECONTRATUELLE D'INFORMATION
1. – Les principes posés par l’article 1112-1 du Code civil concernant l’obligation précontractuelle d’information.
Article 1112-1 du Code civil (à lire attentivement) :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie là lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
2. – L’étendue et l’intensité de cette obligation
L’obligation de renseigner autrui relève, désormais, de l’ordre public.
Cela étant, l’étendue et l’intensité de cette obligation générale d’information varient en fonction de l’objet concerné par la vente, de la qualité des parties, ou encore de la nature du contrat.
Il convient donc de faire une distinction entre :
- l’obligation générale d’information,
- l’obligation de mise en garde,
- l’obligation de conseil.
3. – Le droit d’information suppose la réunion de 3 conditions
3.1 – Première condition : une importance déterminante de l’information pour le débiteur (acheteur)
L’information doit avoir une importance déterminante pour le consentement du cocontractant. Dûment informé, le contractant, soit n’aurait pas conclu le contrat, soit l’aurait conclu à des conditions différentes.
L’alinéa 2 de l’article 1112-1 précisant que le devoir d’information ne porte pas sur « l’estimation de la valeur de la prestation ».
3.2 – Deuxième condition : la connaissance effective de l’information pour le créancier (vendeur).
Le devoir d’informer ne pèse ensuite que sur celui qui « connaît » l’information déterminante, et non, sur celui qui « devrait connaître » l’information.
Toutefois, le professionnel averti d’une part a un devoir de se renseigner pour informer et d’autre part il pèse sur lui une présomption de connaissance.
3.3 – Troisième condition : l’ignorance légitime de l’information par le débiteur (acheteur).
Ce devoir d’informer ne profite enfin qu’à celui qui, « légitimement, ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».
Ainsi, l’ignorance d’une information largement diffusée, ou ne pouvant échapper à un contractant normalement vigilant, sera jugée « illégitime ».
Cette confiance dans le cocontractant pourrait recouvrir l’hypothèse d’un consommateur profane traitant avec un professionnel averti.
3.4 – Un arrêt de la Cour de cassation illustrant cette obligation
Cour de cassation du 14/05/2025, n° 23-17948.
Les faits :
Un associé cède ses parts sociales d’une société exploitant un fonds de commerce de restauration rapide dans un local loué à cet effet. Peu de temps après la conclusion du contrat, le 18 septembre 2018, le cessionnaire se rend, toutefois, compte que le règlement de copropriété et les copropriétaires de l’immeuble concerné s’opposent à l’installation d’un système d’extraction de fumée ou de ventilation pour exercer l’activité de restauration rapide projetée. En somme, il était impossible de faire de la friture dans le local loué.
Le cessionnaire et sa société assignent le cédant en indemnisation pour la dissimulation intentionnelle de cette information conduisant à l’impossibilité d’exercer l’activité souhaitée dans le local pris à bail. En cause d’appel, les juges du fond décident de rejeter cette demande en précisant qu’il n’est pas démontré que l’impossibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement de l’acquéreur à la cession de parts sociales au sens de l’article 1112-1 du code civil.
La Cour de cassation confirme cette décision, en précisant :
Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie.
D’une part, les moyens, pris en leur première branche, qui postulent que le devoir d’information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, ne sont donc pas fondés.
D’autre part, en retenant qu’il n’était pas établi que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement de M. [T], la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, et a procédé à la recherche prétendument omise visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision.
4. – Preuve pour le débiteur et le créancier de l’obligation d’information.
Le législateur a également précisé d’une part, qu’il appartient à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie là lui devait, c’est-à-dire que les trois conditions précitées étaient réunies et d’autre part, si ces conditions sont remplies, il appartient alors au débiteur du devoir d’information de prouver qu’il l’a fournie
(Cour de cassation, chambre civile 1 du 15/05/2002, n° 99-21521).
« Attendu que Mme X… a acquis un véhicule automobile d’occasion auprès de M. Y…, garagiste ;
Qu’une expertise ordonnée en référé a établi que le véhicule avait été accidenté ;
Qu’au soutien de son action en nullité de la vente pour réticence dolosive, Mme X… a fait valoir que le vendeur lui avait dissimulé cet accident ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que Mme X… ne rapportait pas la preuve de cette dissimulation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Le vendeur, Monsieur Y avait une obligation d’information au bénéfice de l’acheteur Madame X.
La connaissance par Madame X que le véhicule avait été accidenté avait une importance déterminante sur son consentement. Si elle avait eu connaissance elle n’aurait peut-être pas conclu le contrat, ou probablement à des conditions différentes.
Monsieur Y avait connaissance de cette information, il avait donc une obligation d’en informer l’acheteur, d’autant plus que Madame X était dans l’ignorance totale de ce fait.
Monsieur Y qui avait donc une obligation précontractuelle d’information, à défaut de prouver qu’il a exécuté cette obligation, le contrat encourt la nullité.
5. – Sanctions du manquement au devoir d’information.
L’article 1112-1 du Code civil rappelle les deux sanctions possibles en cas de manquement au devoir d’information :
- la sanction de principe, la responsabilité extracontractuelle,
- la sanction éventuelle, la nullité.
5.1 – Responsabilité extracontractuelle
En jurisprudence, la Cour de cassation indemnise la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
Cour de cassation, chambre commerciale du 31/01/2012, n° 11-10834 (un exemple intéressant concernant un contrat de franchise).
5.2 – Nullité
Le manquement au devoir d’information pourra également entraîner « l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants », c’est-à-dire lorsqu’il aura provoqué un vice du consentement.
Il en résulte, que si le débiteur invoque une erreur, il devra établir qu’elle porte sur les qualités essentielles de la chose ou de la personne. S’il invoque un dol, il devra apporter la preuve de l’intention de tromper.
En revanche, le caractère déterminant de l’information étant une condition du devoir d’information, le caractère déterminant du vice sera d’ores et déjà établi.
6. – Caractère d’ordre public de l’obligation d’information
Comme pour le devoir de bonne foi, dont il n’est qu’une application, l’ordonnance précise que les parties « ne peuvent ni limiter, ni exclure » le devoir d’information.
On s’est demandé si l’article 1112-1, alinéa 5, ne pourrait pas remettre en cause la validité des clauses exclusives de garantie des vices cachés, dites clauses de « vente en l’état », traditionnellement valables entre professionnels. Cette crainte ne paraît pas fondée. L’objet de cette clause est de prémunir le vendeur professionnel contre la garantie des vices « cachés », c’est-à-dire des vices dont il n’avait pas connaissance, Par conséquent, de deux choses l’une : soit le vendeur n’avait pas connaissance du vice, et il n’était alors guère tenu d’en informer l’acquéreur en application de l’article 1112-1; soit le vendeur avait connaissance du vice, et la clause de « vente en l’état» était d’ores et déjà inefficace.
TROISIEME PARTIE : DEVOIR DE CONFIDENTIALITE
1. – Le devoir de confidentialité défini par l’article 1112-2 du Code civil
« Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun ».
2. – Commentaires
L’ordonnance consacre officiellement l’existence et l’efficacité du devoir de confidentialité, en prévoyant que celui qui, non seulement « utilise », mais également « divulgue », une information confidentielle obtenue lors des négociations engage sa responsabilité.
L’information confidentielle recouvre toute information sensible dont la mise à profit par le partenaire ou par un tiers en ayant eu connaissance pourrait nuire à celui que le secret protège.
C’est-à-dire que toutes les informations communiquées dans le cadre des pourparlers ne sont pas présumées confidentielles, mais qu’elles ne le seront qu’en raison d’une déclaration expresse des parties en ce sens ou en considération de la nature des informations ou de la qualité des partie