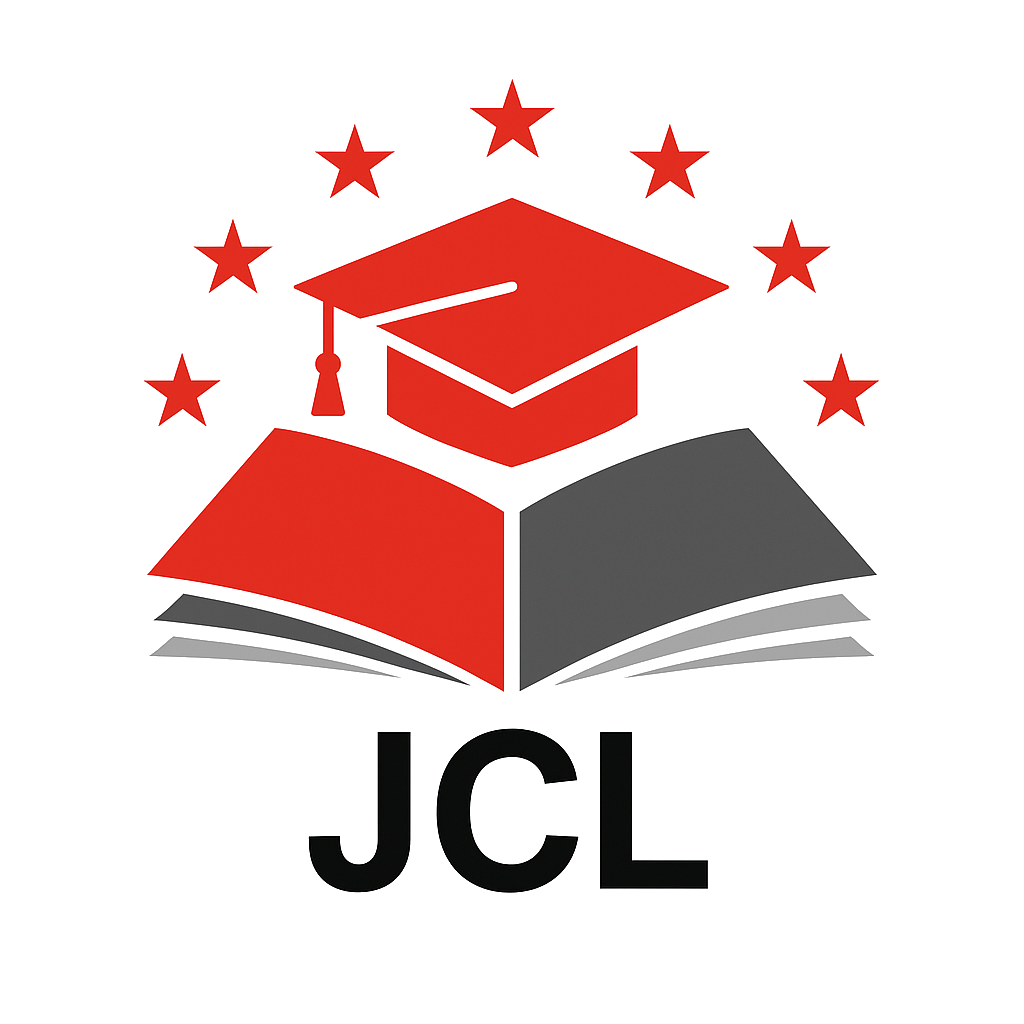4. – Résolution unilatérale du contrat de maintenance interdépendant d’une location financière (Cour de cassation, chambre commerciale du 02/07/2025, n° 24-13046)
Arrêt de la Cour de cassation
Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2024), le 31 octobre 2018 l’association Cours Saint Thomas d’Aquin (l’association) a conclu avec la société Viatelease, aux droits de laquelle se trouve la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam), un contrat de location financière portant sur du matériel de bureautique fourni par la société Burotel, celle-ci en assurant également la maintenance.
Le 25 octobre 2019, se prévalant de manquements graves dans le paramétrage du matériel, l’association a notifié à la société Burotel la résolution du contrat de maintenance.
3. La société Locam a assigné en paiement des loyers impayés l’association, laquelle lui a opposé la caducité du contrat de location financière en conséquence de la résolution du contrat de maintenance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
L’association fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de caducité du contrat de location et de la condamner au paiement du solde impayé du contrat de location, alors « que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; qu’en déboutant l’association de sa demande de prononcer de la caducité du contrat de location du 31 octobre 2018, motif pris que la société Burotel n’a pas été attraite à la procédure, que l’association ne fait valoir aucune procédure antérieure ou distincte au cours de laquelle la résolution du contrat de maintenance la liant à la société Burotel a été prononcée ou constatée et qu’en l’absence de mise en cause de la société Burotel, fournisseur du matériel avec laquelle elle avait souscrit un contrat de maintenance, elle ne pouvait ni constater la résolution du contrat de maintenance, ni prononcer la caducité du contrat de location du 31 octobre 2018, la cour d’appel a violé l’article 1226 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du code civil :
Selon le premier de ces textes, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Aux termes du deuxième, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon le troisième, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.
Il en résulte que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu.
Pour rejeter la demande de caducité du contrat de location financière, l’arrêt relève que l’association n’a pas mis en cause la société Burotel.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.