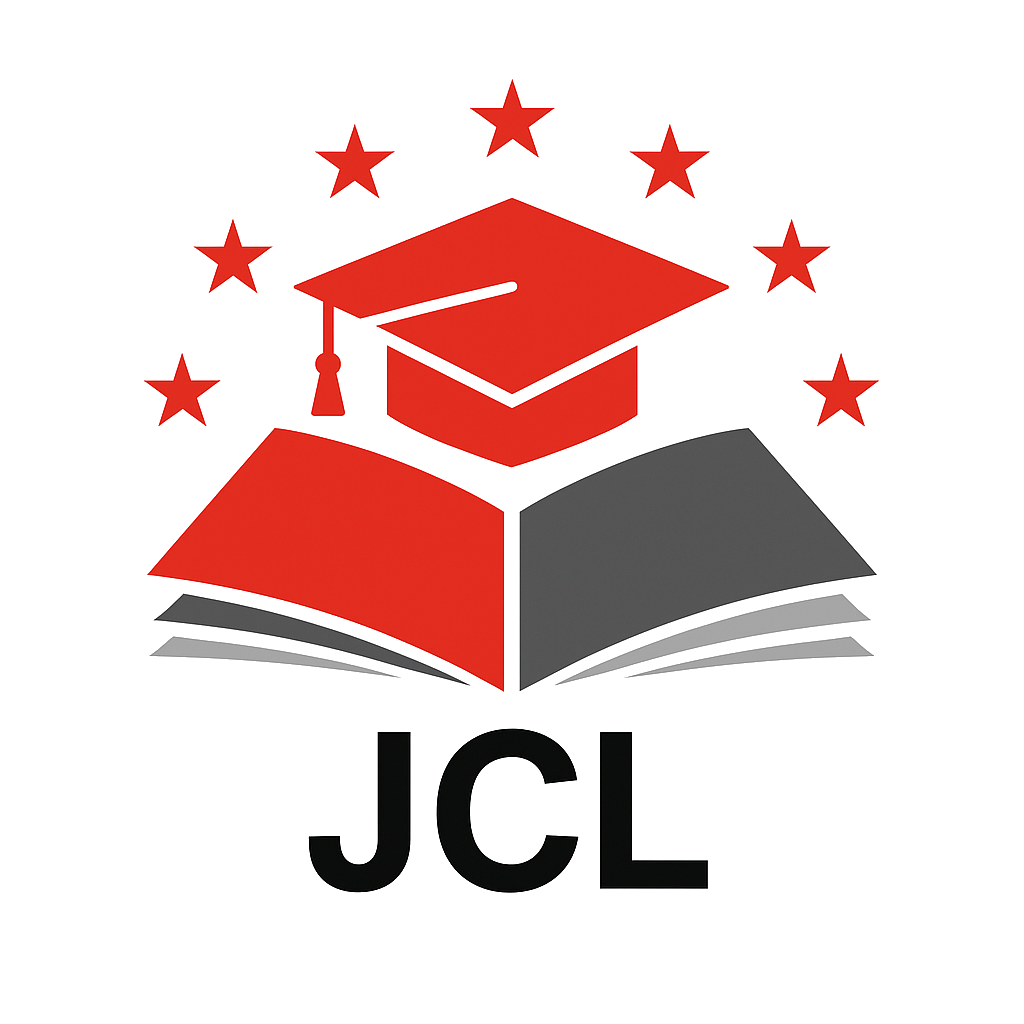1. – La disproportion avant le 01/01/2022
Cette première partie traite des cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, régis par l’article L. 332-1 du Code de la consommation (ancien L. 341-4).
1.1 – L’article L. 332-1 du Code de la consommation.
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Champ temporel. En application de la réforme issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, cet article ne s’applique qu’aux cautionnements signés avant le 01/01/2022.
À compter du 01/01/2022, il convient d’appliquer l’article 2300 du Code civil (cf. Titre 2).
1.2 – Obligations du créancier et sanction de la disproportion.
Le régime antérieur combine l’appréciation de la disproportion au jour de l’engagement et la possibilité, pour le créancier, d’échapper à la sanction s’il prouve qu’au jour de l’appel la caution est revenue à meilleure fortune.
1.2.1 – Les obligations du créancier
L’article L. 332-1 n’impose pas au créancier professionnel une vérification active de la solvabilité de la caution, ni ne fait de la proportionnalité une condition de validité du cautionnement.
Il fait seulement peser sur le créancier le risque d’un engagement manifestement disproportionné au jour de la souscription, sauf si, au jour de l’appel, la caution dispose d’un patrimoine lui permettant d’y faire face.
La disproportion s’apprécie donc à deux moments :
au jour de l’engagement ;
au jour de l’assignation de la caution, pour vérifier l’éventuel retour à meilleure fortune.
1.2.2 – La nature de la sanction
La proportionnalité n’étant pas une condition de validité, la sanction n’est pas la nullité (ni, a fortiori, une résolution d’un contrat unilatéral).
La sanction est une déchéance d’invocabilité : le créancier « ne peut se prévaloir » du cautionnement lorsque l’engagement était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion et qu’aucun retour à meilleure fortune n’est établi au jour de l’appel.
Cette sanction emporte, par principe, décharge totale de la caution (pas de décharge partielle).
1.3 – La mise en œuvre et le champ d’application
1.3.1 – Quelles cautions sont concernées ?
L’article L. 332-1 bénéficie à toute personne physique qui s’est portée caution envers un créancier professionnel, quelle que soit la nature de la dette garantie.
Aucune distinction n’est faite entre cautions averties ou non averties (Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-16.355 ; 1re civ., 30 oct. 2013, n° 12-14.982).
La protection est d’ordre public : elle ne peut faire l’objet d’aucune renonciation anticipée. Est donc nulle la clause par laquelle la caution reconnaîtrait que son engagement n’est pas disproportionné à ses biens et revenus.
1.3.2 – Quels cautionnements sont concernés par la disproportion ?
1.3.2.1 – Cautionnement par acte authentique
Contrairement aux dispositions relatives aux mentions manuscrites, qui ne s’appliquent qu’aux actes sous seing privé, l’article L. 332-1 ne fait aucune distinction.
La sanction de la disproportion s’applique donc également aux cautionnements reçus par acte authentique (art. 1317-1 C. civ. : dispense uniquement des mentions manuscrites).
1.3.2.2 – Le sous-cautionnement
La sous-caution personne physique peut également invoquer l’article L. 332-1, dès lors que le créancier bénéficiaire est un professionnel (Cour d’appel d’Amiens, 7 juillet 2016, n° 14/05361).
1.3.2.3 – Le cofidéjusseur
Lorsqu’une même dette est garantie par plusieurs cautions solidaires, la disproportion invoquée par l’une d’elles est opposable non seulement au créancier professionnel, mais aussi aux autres cautions.
La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt de la première chambre civile du 26 septembre 2018 (n° 17-17.903), que la sanction prévue à l’article L. 332-1 du Code de la consommation prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant payé la dette, ceux-ci exercent leur action récursoire contre la caution déchargée.
Concrètement, la caution qui bénéficie de la disproportion est assimilée à un codébiteur devenu insolvable. Sa part se reporte alors sur les autres cautions, qui doivent assumer l’intégralité de la dette résiduelle avec le débiteur principal.
Exemple pratique :
A, B et C cautionnent solidairement un prêt de 100 000 euros. La banque appelle A en paiement de 90 000 euros. A paie et se retourne contre B pour obtenir 30 000 euros. B prouve que son engagement était manifestement disproportionné. Dans ce cas, A ne peut rien lui réclamer. La dette restante se partage entre A et C, soit 45 000 euros chacun.
📌 Note explicative
Cette solution vaut uniquement en présence de cautions solidaires.
Si les cautionnements ne sont pas solidaires, chaque caution n’est tenue qu’à concurrence de son propre engagement. La disproportion invoquée par l’une n’a alors aucune incidence sur les autres : le créancier ne peut pas leur réclamer la part devenue inexécutable, ce qui réduit simplement le gage global du créancier.
1.3.2.4 – L’aval
L’aval apposé sur un titre régulier est un engagement cambiaire régi par le droit du change. L’avaliste ne peut donc pas invoquer ni le devoir de mise en garde, ni l’article L. 332-1 (Cour de cassation, chambre commerciale du 30 oct. 2012, n° 11-23.519).
En revanche, si le titre est irrégulier, l’aval peut être requalifié en cautionnement. Dans ce cas, les règles protectrices du droit du cautionnement, et notamment celles relatives à la disproportion, trouvent à s’appliquer (Cour de cassation, chambre commerciale du 5 juin 2012, n° 11-19.627).
1.3.3 – Quels créanciers sont concernés par la disproportion ?
L’article L. 332-1 vise expressément les créanciers professionnels.
La Cour de cassation a donné une définition large : est créancier professionnel celui « dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale ».
Cette qualification s’applique même en présence d’une intervention isolée ou exceptionnelle.
Relèvent de cette catégorie notamment :
les établissements de crédit et les sociétés de caution mutuelle ;
les sociétés d’assurance agréées pour l’activité de cautionnement ;
les bailleurs professionnels ;
les fournisseurs de biens ou de services (ex. fournisseurs de matériaux, brasseurs) ;
les sociétés civiles immobilières exerçant une véritable activité professionnelle.
En revanche, une société civile immobilière qui se borne à gérer un patrimoine familial n’est pas considérée comme un créancier professionnel.
1.4 – Appréciation de la disproportion
L’article L. 332-1 du Code de la consommation impose une double vérification :
d’abord, que l’engagement n’était pas manifestement disproportionné au jour de sa conclusion ;
ensuite, que le patrimoine de la caution ne lui permettait pas de faire face au moment où elle est appelée.
L’appréciation de la disproportion implique donc :
l’examen des biens et revenus de la caution au moment de la signature de l’acte (1.4.1) ;
la vérification de sa capacité à exécuter son engagement lors de l’appel en garantie (1.4.2).
1.4.1 – Disproportion manifeste à la date de l’engagement
1.4.1.1 – Biens et revenus à prendre en compte
L’appréciation du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution au jour de sa conclusion suppose un examen complet de sa situation patrimoniale.
➤ Des biens immobiliers
Tous les immeubles de la caution doivent être intégrés, y compris le logement de famille.
Le fait que certains biens soient insaisissables (par exemple résidence principale ou biens professionnels protégés) n’exclut pas leur prise en compte, car l’insaisissabilité n’affecte pas la valeur patrimoniale (nous reviendrons plus en détail sur ce point au 1.4.1.2).
➤ Des biens mobiliers et valeurs patrimoniales
Comptes bancaires, livrets, contrats d’assurance-vie, portefeuilles de titres.
Parts sociales ou actions détenues par la caution dans la société débitrice.
Compte courant d’associé, qui constitue un actif réalisable et doit donc être retenu.
- Dans un arrêt du 05/11/2025, n° 24-16389, la Cour de cassation précise que les biens mobiliers doivent être pris en compte, quand bien même ils n’auraient pas été immédiatement disponible (en l’espèce il s’agissait d’un fonds de capitalisation retraite)
➤ Des revenus
Les revenus professionnels et salariaux réguliers, y compris ceux provenant de la société débitrice, dès lors qu’ils existaient au moment de l’acte et avaient vocation à perdurer.
Les revenus fonciers et mobiliers doivent aussi être intégrés.
En revanche, les espérances de gains liés au succès de l’opération financée ne doivent pas être retenues, car leur caractère aléatoire les rend impropres à mesurer la solvabilité.
➤ Principe de proportionnalité
Dès lors que la valeur globale des biens et revenus couvre le montant du cautionnement, l’engagement ne peut être jugé disproportionné.
À l’inverse, si le montant de l’engagement excède notablement la valeur du patrimoine et des revenus disponibles, la disproportion est caractérisée.
1.4.1.2 – Prise en compte des biens insaisissables
Une question sensible est celle de savoir si les biens insaisissables doivent être intégrés dans le calcul de la proportionnalité du cautionnement.
➤ Solution jurisprudentielle
La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 18 janvier 2017 (chambre commerciale, n° 15-12.723), que l’insaisissabilité d’un bien n’empêche pas sa prise en compte pour apprécier la disproportion.
En effet, l’insaisissabilité ne modifie pas la consistance du patrimoine de la caution : un bien insaisissable reste un élément de richesse, révélateur de la solvabilité de la caution.
➤ Biens concernés
Le logement principal, protégé par l’article L. 526-1 du Code de commerce (déclaration d’insaisissabilité avant 2015, protection automatique depuis la loi Macron).
Les biens professionnels insaisissables (fonds de commerce, outillage, etc.), lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle indépendante de la caution.
➤ Conséquence pratique
Même si le créancier ne peut pas saisir directement ces biens, ils doivent être intégrés au calcul. Cela a deux effets :
Augmenter la valeur patrimoniale prise en compte → donc réduire les hypothèses de disproportion.
Créer une apparente contradiction : la caution peut être jugée solvable (parce qu’elle possède un bien insaisissable), alors même que ce bien échappe au droit de gage du créancier.
➤ Intérêt pour le juge consulaire
Cette règle illustre bien la logique de l’article L. 332-1 : ce n’est pas une protection de gage pour le créancier, mais une mesure de protection de la caution. La question n’est donc pas de savoir ce que le créancier peut saisir, mais de mesurer objectivement si la caution avait une richesse suffisante au jour de l’engagement.
1.4.1.3 – Prise en compte des espérances de gain provenant de l’opération financée ?
1.4.1.4 – Revenus et patrimoine à prendre en compte en cas de pluralité de garants
Lorsqu’un même engagement est garanti par plusieurs cautions, la disproportion doit être appréciée individuellement pour chacune d’elles.
➤ Règle générale
Chaque caution doit démontrer, au regard de ses biens et revenus propres, que son engagement est manifestement disproportionné.
Même en présence de cautionnements solidaires, l’appréciation ne se fait pas globalement : la solvabilité de l’une ne peut compenser l’insolvabilité de l’autre.
➤ Conséquence pratique
En cas de cautionnement solidaire, chaque caution est évaluée sur la totalité de la dette garantie, et non sur une quote-part théorique.
Ainsi, le cautionnement n’est pas proportionné si l’engagement d’une caution, pris isolément, excède manifestement ses capacités financières, même si l’autre caution aurait pu couvrir la dette.
➤ Illustration jurisprudentielle
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 2 février 2022 (n° 20-22.938), a précisé que lorsque deux époux mariés sous le régime de la communauté se portent cautions d’une même créance en donnant leur accord exprès, l’appréciation de la proportionnalité doit se faire en tenant compte de la somme des deux engagements, c’est-à-dire sur la base du patrimoine du ménage.
1.4.1.5 – Revenus et patrimoine à prendre en compte dans le cas des époux mariés sous communauté de biens
L’article 1415 du Code civil limite l’engagement d’un époux caution sans le consentement de l’autre aux seuls biens propres et revenus personnels.
Mais cette règle, qui définit l’étendue du gage du créancier, n’empêche pas que les biens communs soient pris en compte pour apprécier la proportionnalité du cautionnement.
| Situation | Biens communs | Biens propres + revenus de l’époux caution | Biens propres + revenus du conjoint | Référence |
|---|
| 1. Les deux époux signent le même acte | Inclus | Inclus | Inclus | Com., 5 févr. 2013, n° 11-18.644 |
| 2. Les deux époux signent par actes séparés | Inclus (si l’un est poursuivi) | Inclus pour l’époux poursuivi | Exclus (sauf si le conjoint est aussi poursuivi) | — |
| 3. Un seul époux signe avec consentement exprès du conjoint | Inclus | Inclus | Inclus (y compris salaires, biens communs) | Com., 22 févr. 2017, n° 15-14.915 |
| 4. Un seul époux signe sans consentement du conjoint | Inclus (même si non saisissables par le créancier) | Inclus | Exclus | Com., 6 juin 2018, n° 16-26.182 |
Lecture rapide : Acte commun ou consentement exprès → tout le patrimoine du ménage est pris en compte. Dans un arrêt du 05/11/2025 (n° 24-18984) la Cour de cassation a jugé qu’en cas d’acte commun, le consentement d’un époux pour l’autre reste acquis; même dans l’hypothèse ou l’un des engagements est déclaré disproportionné.
Actes séparés ou absence de consentement → seule la situation de l’époux caution est prise en compte, mais les biens communs entrent toujours dans l’assiette.
1.4.1.6 – Quels revenus et patrimoine prendre en compte dans le cas des époux séparés de biens ou sous le régime de la participation aux acquêts, ainsi que les époux pacsés ou en concubinage.
Lorsque les partenaires ou concubins n’ont pas de biens communs de droit, la règle est plus simple : la proportionnalité s’apprécie individuellement pour chaque caution.
➤ Époux séparés de biens
L’assiette de l’évaluation comprend les biens propres de l’époux caution, ainsi que, le cas échéant, sa quote-part indivise sur des biens acquis en indivision.
Le créancier peut en effet demander le partage des biens indivis, de sorte que cette fraction a une valeur patrimoniale réelle.
La Cour de cassation (chambre commerciale, 24 mai 2018, n° 16-23.036) a jugé que l’évaluation doit être faite au regard du patrimoine personnel de chaque époux.
La première chambre civile, le 19 janvier 2021 (n° 20-20.467), a confirmé cette logique : même si les deux époux séparés de biens se portent cautions d’une même dette, la proportionnalité s’apprécie séparément pour chacun.
➤ Partenaires pacsés
Le régime du PACS n’institue pas de communauté patrimoniale par défaut.
La proportionnalité s’apprécie donc de la même manière que pour les époux séparés de biens : chaque partenaire est examiné individuellement, sauf si un bien indivis a été acquis ensemble, auquel cas sa quote-part est incluse.
➤ Concubins
Conséquence pratique : Dans ces trois hypothèses, il n’y a pas de mise en commun automatique des patrimoines. Le juge doit apprécier séparément la proportionnalité pour chaque caution, en tenant compte uniquement de son patrimoine personnel et de sa quote-part sur les biens indivis.
1.4.1.7 – Déduction du passif existant et des charges incombant à la caution
L’appréciation de la disproportion ne peut se limiter à l’actif de la caution : il faut également prendre en compte son passif et ses charges au jour de la souscription de l’acte.
➤ Dettes et charges personnelles
Les dettes déjà contractées (prêts en cours, découverts, crédits à la consommation) doivent être déduites des biens et revenus.
Les charges de famille (pension alimentaire, frais de subsistance liés aux enfants à charge) doivent également être retenues.
➤ Autres engagements de caution
Les autres cautionnements déjà souscrits avant l’acte litigieux doivent être intégrés, puisqu’ils grèvent la capacité de la caution.
En revanche, les cautionnements postérieurs ne sont pas pris en compte, puisqu’ils n’existaient pas au jour de la conclusion.
➤ Exceptions
Si un cautionnement antérieur a été rétroactivement annulé, il doit être exclu du calcul (Cour de cassation, chambre commerciale, 21 novembre 2018, n° 16-25.128).
En revanche, si un engagement antérieur a déjà été jugé disproportionné, il reste intégré dans le passif de la caution (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 septembre 2015, n° 13-24.568).
➤ Conséquence pratique
Le juge doit raisonner sur la capacité réelle de remboursement de la caution, en soustrayant de ses biens et revenus disponibles toutes les dettes existantes et charges au moment de la signature de l’acte.
1.4.1.8 – La charge de la preuve
Il appartient en principe à la caution qui invoque la disproportion de prouver, au jour de la signature de l’acte, que son engagement était manifestement excessif par rapport à ses biens et revenus.
Le créancier n’a donc pas l’obligation de démontrer la proportionnalité, sauf lorsqu’il entend se prévaloir d’un retour à meilleure fortune au jour de l’appel en garantie (voir § 1.4.2.4).
La charge de la preuve se décline différemment selon que le créancier a ou non fait remplir une fiche de renseignements.
1.4.1.8.1 – La caution a rempli une fiche de renseignements
Le créancier peut en principe se fier aux informations communiquées par la caution.
Si la fiche est signée, même si elle a été remplie par un tiers, la caution est liée par son contenu, sauf en cas d’anomalie apparente.
La Cour de cassation (chambre commerciale, 4 juillet 2018, n° 17-13.128 ; 24 mars 2021, n° 19-21.254) admet ainsi que le créancier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des données, sauf incohérence manifeste (par exemple, omission de revenus essentiels ou souscription d’un autre cautionnement connu du créancier).
En revanche, une fiche manifestement incomplète ou incohérente engage la responsabilité du créancier s’il ne réagit pas (CA Versailles, 12 mars 2019, n° 17/07881).
La caution ne peut ensuite invoquer une situation moins favorable que celle déclarée, sauf si la déclaration n’était pas signée, signée postérieurement à l’acte, ou comportait une anomalie apparente (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 septembre 2021, n° 20-14.660 ; 13 mars 2024, n° 22-19.900).
1.4.1.8.2 – La banque n’a pas fait remplir de fiche de renseignements
Aucune disposition légale n’impose au créancier professionnel de solliciter une fiche patrimoniale avant de faire signer un cautionnement.
L’absence de fiche n’entraîne donc pas automatiquement la disproportion du cautionnement.
➤ Effet sur la charge de la preuve
La charge de la preuve reste sur la caution : c’est à elle de démontrer, par tous moyens, que son engagement était disproportionné.
Toutefois, en l’absence de fiche, la caution peut produire librement tous éléments de passif ou de charges (autres crédits, cautionnements antérieurs, charges de famille…).
La Cour de cassation (chambre commerciale, 4 avril 2024, n° 22-21.880) a précisé qu’en l’absence de fiche, la caution n’est pas tenue de révéler spontanément ses engagements antérieurs.
➤ Conséquence pour le juge consulaire
L’argument souvent avancé par les cautions (« la banque ne m’a pas demandé de fiche ») n’est pas suffisant pour les décharger.
Le tribunal doit rappeler qu’aucun texte n’impose une telle formalité au créancier.
Mais en contrepartie, l’absence de fiche fragilise la position du créancier : la caution pourra invoquer tous ses engagements et charges, et le juge devra les intégrer dans l’appréciation.
Enfin, si la caution n’apporte aucun élément probant, sa défense ne peut prospérer (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017, n° 15-20.294).
« Si le créancier n’a pas sollicité de fiche patrimoniale, il s’expose au risque de voir la caution invoquer librement l’ensemble de son passif. Mais cette omission ne renverse pas la charge de la preuve : il appartient toujours à la caution de démontrer que son engagement était manifestement disproportionné. »
📌 Lecture pratique :
Avec fiche signée : le créancier est protégé, sauf anomalies manifestes.
Sans fiche : la caution a plus de latitude pour prouver la disproportion, mais doit tout de même apporter des éléments sérieux ; l’absence de fiche ne suffit pas.
1.4.1.9 – Une approche du calcul de la disproportion
1.4.1.9.1 – Cautionnements jugés disproportionnés par la jurisprudence
1.4.1.9.2 – Cautionnements jugés non disproportionnées par la jurisprudence
- Engagement de caution de 791.434,80 euros ; titulaire d’un compte bancaire d’un montant de 106.352,47 euros, d’une maison évaluée à 323.400 et d’un revenu annuel imposable de 170.000, il n’est donc pas établit le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution (Cour d’appel Versailles du 06/05/2014, n° 13/01549).
- Engagement de caution de 71 875 euros, alors que ses revenus étaient de 12 000 euros par an et qu’elle ne disposait pour tout patrimoine que d’un portefeuille de titre et une assurance-vie pour un total 65 311 euros (Cour d’appel de Rennes du 23/04/2019, n° 16/09370).
1.4.1.9.3 – Une proposition de raisonnement pour définir la notion de disproportion
La Cour de cassation a rappelé (chambre commerciale, 28 février 2018, n° 16-24.841 ; chambre commerciale, 9 octobre 2019, n° 18-16.798) que la disproportion s’apprécie au regard de la capacité de la caution à honorer son propre engagement avec ses biens et revenus, et non en fonction des échéances du prêt garanti.
📌 Attention : le critère bancaire usuel du taux d’endettement de 33 % ne peut pas être transposé.
La caution n’est pas un emprunteur.
Le rôle du juge n’est pas de vérifier si les mensualités représentent moins d’un tiers des revenus, mais de mesurer si la caution peut ou non assumer l’engagement global.
Méthode conseillée pour le juge :
Calculer le patrimoine net de la caution (actif – passif).
Retrancher ce patrimoine du montant du cautionnement → déterminer le reliquat.
Vérifier si ce reliquat est remboursable en deux ans avec les revenus réguliers (art. 1343-5 du Code civil).
Exemple 1 – Disproportion caractérisée
Cautionnement : 100 000 €.
Patrimoine : 20 000 € (par ex. épargne disponible).
Revenus mensuels : 1 500 €, soit 18 000 € par an.
👉 Étape 1 : patrimoine mobilisable = 20 000 € → reste 80 000 € à couvrir.
👉 Étape 2 : capacité de remboursement sur deux ans avec 1 500 €/mois = 36 000 €.
👉 Étape 3 : 80 000 € – 36 000 € = déficit de 44 000 €.
➡️ La caution ne peut pas assumer son engagement dans les deux ans → disproportion manifeste.
Exemple 2 – Disproportion écartée malgré un taux d’endettement élevé
👉 Étape 1 : patrimoine mobilisable = 20 000 € → reste 80 000 € à couvrir.
👉 Étape 2 : capacité de remboursement sur deux ans avec 5 000 €/mois = 120 000 €.
👉 Étape 3 : 80 000 € – 120 000 € = capacité excédentaire de 40 000 €.
➡️ Même si le taux d’endettement apparent dépasse largement 33 %, la caution pouvait objectivement rembourser son engagement dans les deux ans → pas de disproportion manifeste.
📌 Lecture pratique pour le juge consulaire :
Le juge doit raisonner sur la capacité réelle de remboursement à court terme (deux ans), et non sur le confort de vie ou un pourcentage de revenus absorbés.
L’engagement peut être proportionné même s’il “asphyxie” la caution pendant deux ans, dès lors que le droit positif n’impose pas un reste à vivre minimum.
1.4.2 – Incapacité de faire face à l’engagement lors de l’appel de la garantie
L’article L. 332-1 du Code de la consommation prévoit que la disproportion constatée à la date de l’engagement ne suffit pas, à elle seule, à libérer la caution.
Encore faut-il que, au moment où le créancier l’appelle en paiement, son patrimoine ne lui permette pas de faire face à son obligation.
1.4.2.1 – Condition préalable
👉 Si le cautionnement est jugé proportionné à la date de la signature, il n’y a pas lieu d’examiner la situation de la caution au jour de sa mise en cause.
La caution ne peut pas invoquer une dégradation postérieure de ses revenus ou de son patrimoine pour se libérer.
C’est la logique même du système : l’article L. 332-1 protège contre un engagement initialement excessif, mais n’offre pas de garantie en cas d’appauvrissement ultérieur d’une caution qui avait signé un cautionnement proportionné.
1.4.2.1 – La notion de retour à meilleure fortune
Le retour à meilleure fortune suppose que, au jour de l’appel en paiement, la caution dispose d’un patrimoine suffisant pour couvrir son engagement.
📌 Précision essentielle : à ce stade, le texte n’évoque plus les revenus, mais seulement le patrimoine.
L’augmentation de revenus postérieurs (par exemple une hausse de salaire) n’est donc pas suffisante si elle ne s’est pas traduite par une augmentation effective du patrimoine.
Ce sont les biens disponibles (immeubles, épargne, valeurs mobilières, etc.) qui seuls permettent de caractériser un retour à meilleure fortune.
Exemple :
Une caution qui percevait 2 000 €/mois au jour de la souscription, puis 4 000 €/mois au jour de l’appel, mais qui n’a pas constitué d’épargne ni acquis de nouveaux biens, ne peut être considérée comme revenue à meilleure fortune.
À l’inverse, une caution qui hérite d’un bien immobilier, rembourse une part importante de ses dettes ou vend un actif pour dégager du capital, peut être regardée comme disposant d’un patrimoine suffisant pour faire face à son engagement.
1.4.2.2 – Appréciation de l’aptitude à faire face à l’engagement
L’évaluation doit inclure l’endettement global de la caution, y compris ses autres engagements de caution (Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-21.857).
Il ne suffit pas de constater l’existence de liquidités ponctuelles : il faut examiner l’ensemble de l’actif et du passif (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-31.011).
1.4.2.3 – Date à laquelle l’aptitude de la caution à faire face à son engagement doit être appréciée.
En principe, la date pertinente est celle de l’assignation en paiement et non celle du jugement (Cass. com., 9 juillet 2019, n° 17-31.346).
Exception : en cas de plan de sauvegarde, la date retenue est celle où le plan cesse d’être exécuté (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-16.402).
1.4.2.4 – Charge de la preuve de l’aptitude à faire face à l’engagement
Si la disproportion est démontrée à la date de l’engagement, il appartient alors au créancier de prouver que la caution dispose, au jour de l’appel, d’un patrimoine suffisant pour honorer son engagement.
Cass. com., 4 avril 2024 (n° 22-21.880) : la cour d’appel a été censurée pour avoir inversé cette charge en exigeant que la caution démontre elle-même sa solvabilité actuelle.
📌 Lecture pratique pour le juge consulaire :
Deux étapes d’examen seulement si la disproportion existe au départ.
Proportionné au jour de l’engagement → fin de la discussion.
Disproportionné au départ → il faut alors vérifier si la caution est toujours incapable de faire face au jour de l’appel, sauf retour à meilleure fortune démontré par le créancier.
1.5 – Sanction du défaut de proportionnalité
La sanction prévue par l’article L. 332-1 du Code de la consommation ne joue pas automatiquement.
Elle suppose que la caution invoque expressément le caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la souscription.
📌 Le juge ne peut pas relever d’office cette disproportion : il s’agit d’une défense au fond qui doit être soulevée par la caution (Cass. com., 21 oct. 2018, n° 17-11.420).
Si la disproportion est établie, l’examen se poursuit à la date de la mise en cause (assignation en paiement).
👉 Mais là encore, le juge ne peut pas agir de sa propre initiative :
Il appartient au créancier d’invoquer et de démontrer un éventuel retour à meilleure fortune de la caution.
Si le créancier ne soulève rien, le juge ne peut pas rechercher d’office si la situation patrimoniale de la caution s’est améliorée.
En résumé :
La caution doit soulever la disproportion initiale ;
Le créancier peut répondre en invoquant un retour à meilleure fortune ;
Le juge tranche, mais ne peut soulever ni l’un ni l’autre d’office.
Lorsque la disproportion est démontrée à la souscription et non écartée par un retour à meilleure fortune établi par le créancier, le cautionnement devient inopposable : le créancier « ne peut se prévaloir » de l’acte. La caution est alors totalement déchargée.
1.5.1 – Libération pure et simple de la caution
La proportionnalité n’étant pas une condition de validité du cautionnement, la sanction n’est pas la nullité.
Il ne s’agit pas non plus d’une résolution : le cautionnement est unilatéral et ne crée pas d’obligation réciproque.
La sanction est une déchéance : la caution est purement et simplement libérée de son engagement (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-25.651).
📌 Conséquence : il n’existe pas de libération partielle. Soit le cautionnement est proportionné, soit il ne l’est pas : dans ce cas, il est totalement inopposable au créancier.
1.5.2 – Conséquences de la décharge de la caution
2. – La disproportion en application de l’article 2300 du Code civil (applicable à compter des actes signés le 01/01/2022).
2.1 – Le texte
Article 2300 du Code civil applicable à compter du 01/01/2022
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
2.2 – Première modification : une appréciation figée à la date de souscription
Contrairement à l’article L. 332-1 du Code de la consommation, l’article 2300 ne prévoit plus de double examen.
👉 Désormais, la disproportion ne s’analyse qu’au jour de la signature de l’acte.
Si le cautionnement est proportionné à cette date, la caution reste tenue, même si elle est ruinée par la suite.
Si le cautionnement est disproportionné, le créancier ne peut pas se prévaloir d’une amélioration ultérieure de la situation patrimoniale de la caution.
Conséquence pratique pour le juge consulaire :
L’examen de la disproportion est figé au moment de la souscription. La notion de retour à meilleure fortune disparaît.
2.3 – Deuxième modification : une sanction nouvelle, la réduction
Sous l’empire de l’article L. 332-1, la sanction était la décharge totale de la caution.
Avec l’article 2300, la sanction devient une réduction de l’engagement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager.
📌 Exemple :
Cautionnement : 100 000 €
Patrimoine net disponible au jour de la signature : 40 000 €
Revenus mensuels permettant un remboursement de 20 000 € sur deux ans
👉 Le juge pourra réduire l’engagement de la caution à 60 000 € (40 000 € + 20 000 €), au lieu de l’annuler totalement.
2.4 – Rôle du juge
Le juge doit procéder en deux étapes :
Vérifier si le cautionnement était manifestement disproportionné au jour de sa signature.
Déterminer, si oui, à quelle hauteur la caution pouvait raisonnablement s’engager à cette date.
Ce second point est délicat :
Pour le patrimoine, l’évaluation est assez simple.
Pour les revenus, il reste à déterminer quelle part de revenus mensuels peut être affectée au remboursement et sur quelle durée (la référence des deux ans, issue de l’article 1343-5 du Code civil, semble pertinente mais n’est pas encore stabilisée).
2.5 – Problématiques pratiques attendues
Comment fixer la proportion de revenus à retenir (reste à vivre de la caution) ?
Peut-on tenir compte de biens insaisissables dans la fixation du montant maximal de l’engagement (alors que la jurisprudence antérieure les incluait pour mesurer la disproportion) ?
Les juridictions du fond devront progressivement tracer les contours de ce nouveau régime.
📌 Lecture pratique pour le juge consulaire :
À partir du 01/01/2022, un seul test : la proportionnalité au jour de la souscription.
La sanction n’est plus la décharge totale mais une réduction à due proportion.
Le rôle du juge est central : il doit fixer lui-même le montant maximal supportable par la caution.
3. – Prescription de l’exception de disproportion
3.1 – Une défense au fond et non une action autonome
La caution ne peut pas agir de manière préventive pour faire constater la disproportion de son engagement.
👉 Elle ne peut l’invoquer qu’au moment où elle est poursuivie par le créancier en exécution de son cautionnement.
La disproportion est donc une défense au fond et non une action autonome.
3.2 – L’imprescriptibilité de l’exception
Puisqu’il s’agit d’une défense au fond, elle n’est pas soumise à la prescription.
La Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale du 21 octobre 2018, n° 17-11.420) a jugé que la demande fondée sur la disproportion :
📌 Autrement dit, même si plusieurs années se sont écoulées depuis la conclusion de l’acte de cautionnement, la caution pourra toujours opposer la disproportion au créancier lorsqu’elle est assignée.
3.3 – Conséquence pratique
Pour le juge consulaire :
La disproportion peut être soulevée à tout moment de l’instance tant que la caution est poursuivie en paiement.
Le juge doit l’examiner, dès lors que la caution l’invoque, même si l’acte de cautionnement a été conclu depuis longtemps.
En revanche, le juge ne peut jamais relever la disproportion d’office.
📌 Résumé :
La disproportion est une défense au fond → elle doit être invoquée par la caution.
Elle est imprescriptible → le créancier ne peut pas opposer un délai.
Le juge consulaire doit donc l’examiner dès qu’elle est soulevée, quelle que soit l’ancienneté de l’acte.