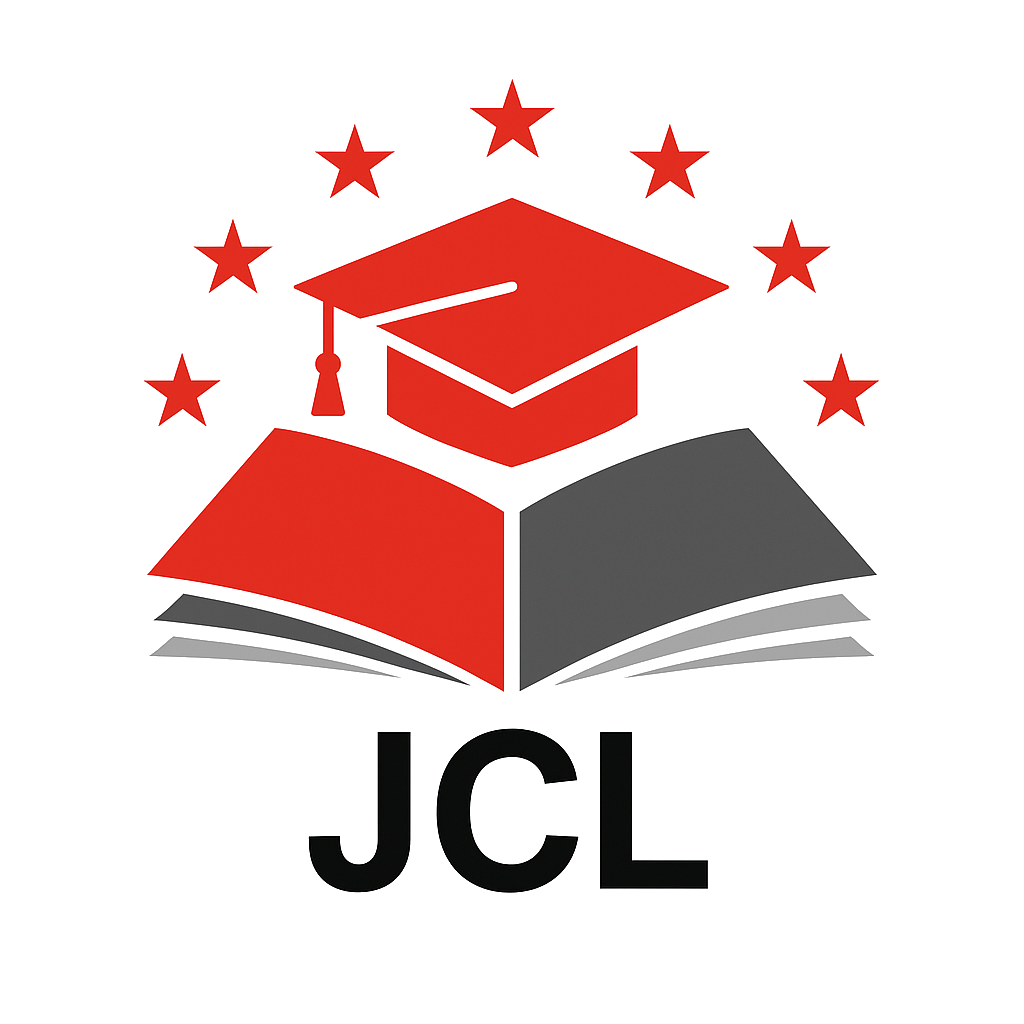Cautionnement : débiteur principal
en procédure collective
en procédure collective
- Chapitre préliminaire. – Enjeu de l’étude
- 1 – La période d’observation
-
2 – La période du plan de sauvegarde ou de redressement
- 2.1 – Principe : interdiction des poursuites contre les cautions personnes physiques
- 2.2 – Absence de protection pour les cautions personnes morales
- 2.3 – Les mesures conservatoires pendant le plan
- 2.4 – Les conséquences du non-respect du plan
- 2.5 – Les conséquences du respect intégral du plan
- 2.6 – Portée pratique
- 3 – La liquidation judiciaire
- 4 – Les conditions à remplir par le créancier pour agir contre la caution
Chapitre préliminaire. – Enjeu de l’étude
Le cautionnement est directement impacté par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur principal.
Le créancier, qui ne peut plus poursuivre librement le débiteur en raison de la suspension des poursuites, cherchera à se tourner vers la caution.
L’enjeu est donc de déterminer dans quelles conditions le créancier peut agir contre la caution, selon les différentes étapes de la procédure (période d’observation, plan, liquidation) et selon la nature de la caution (personne physique ou personne morale).
La réponse n’est pas uniforme : elle résulte d’un équilibre entre la protection de la caution et le maintien des droits du créancier, tel qu’interprété par la jurisprudence.
1 – La période d’observation
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire entraîne une suspension générale des poursuites individuelles contre le débiteur principal (article L. 622-21 du Code de commerce).
Se pose alors la question du sort de la caution : bénéficie-t-elle de cette protection ou reste-t-elle exposée aux poursuites du créancier ?
1.1 – La suspension des poursuites contre les cautions personnes physiques
L’article L. 622-28 du Code de commerce, applicable en sauvegarde et en redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, prévoit que le jugement d’ouverture suspend non seulement les actions et poursuites individuelles contre le débiteur, mais aussi celles engagées contre les cautions personnes physiques, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté réelle pour autrui.
Ainsi, pendant toute la période d’observation, aucune action en justice ni poursuite ne peut être engagée ou poursuivie contre la caution personne physique pour obtenir le paiement de la dette garantie.
La Cour de cassation rappelle que cette suspension est d’ordre public :
elle s’impose même si la caution avait renoncé à toute exception dans son engagement,
elle s’applique quelle que soit la nature de la dette garantie,
elle ne dispense pas le créancier de déclarer sa créance au passif pour conserver ses droits contre la caution.
Cette protection vise à éviter que le créancier, en contournant la procédure collective, ne fasse pression indirectement sur le débiteur par l’intermédiaire de sa caution.
1.2 – L’action possible contre les cautions personnes morales
La protection instaurée par l’article L. 622-28 est strictement limitée aux cautions personnes physiques.
Les cautions personnes morales (par exemple une société mère caution de sa filiale) restent donc exposées aux poursuites pendant la période d’observation, nonobstant la suspension des poursuites contre le débiteur principal.
En pratique, le créancier peut donc agir immédiatement contre une société caution, même si le débiteur principal bénéficie du gel des poursuites.
1.3 – Les mesures conservatoires à l’encontre de la caution
L’article L. 622-28, alinéa 3 du Code de commerce (applicable par renvoi de l’article L. 631-14 en redressement judiciaire) précise que :
« Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action contre les cautions personnes physiques. Toutefois, le créancier peut prendre des mesures conservatoires. »
Il en résulte que, malgré la suspension des poursuites, le créancier conserve la faculté d’obtenir des mesures conservatoires (par exemple, hypothèque judiciaire provisoire ou saisie conservatoire) sur les biens de la caution personne physique.
1.3.1 – Nécessité d’obtenir un titre exécutoire dans le mois
Le Code des procédures civiles d’exécution (article L. 511-4) impose que le bénéficiaire d’une mesure conservatoire introduise, dans le délai d’un mois, une procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire.
Le créancier doit donc, dans ce délai, assigner la caution, quand bien même l’article L. 622-28 interdit en principe toute action en paiement pendant la période d’observation.
1.3.2 – Solution jurisprudentielle
La Cour de cassation a précisé, dans plusieurs arrêts récents (Cour de cassation, chambre commerciale du 21 octobre 2020, n° 19-16185 ; du 8 septembre 2021, n° 19-25686 ; du 5 mars 2025, n° 23-20.357), que :
L’instance engagée dans le délai légal d’un mois doit aller à son terme et permettre au créancier d’obtenir un titre exécutoire contre la caution.
Toutefois, l’exécution de ce titre est suspendue tant que la créance n’est pas exigible vis-à-vis de la caution, c’est-à-dire :
jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, ou
jusqu’au non-respect du plan adopté.
À cette jurisprudence s’ajoute une précision importante :
Le juge qui statue sur la demande de titre exécutoire à l’encontre de la caution doit vérifier l’existence de la créance déclarée au passif du débiteur principal.
En l’absence de déclaration de créance, aucune action contre la caution n’est possible (Cour de cassation, chambre commerciale du 20 mai 1997, n° 95-16696).
Si la créance est contestée devant le juge-commissaire, le juge saisi contre la caution ne peut pas se prononcer sur son existence. Il doit alors surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire (Cour de cassation, chambre commerciale du 5 avril 2016, n° 14-20920).
Ainsi, le titre exécutoire ne peut être accordé que si la créance a été déclarée et qu’elle n’est pas sérieusement contestée, le juge devant se limiter à constater cette régularité.
1.3.3 – Portée pratique
Le créancier doit donc impérativement agir dans le mois pour ne pas perdre le bénéfice de sa mesure conservatoire.
Mais il ne pourra mettre à exécution le titre obtenu qu’au moment où la créance deviendra exigible vis-à-vis de la caution.
Cette solution assure un équilibre :
elle permet au créancier de préserver son droit,
tout en protégeant la caution contre une exécution prématurée.
1.3.4 – Un exemple de jugement
» Par acte sous seing privé, en date du 8 octobre 2014, Monsieur Alain JANET s’est porté caution solidaire, au bénéfice de la BANQUE CANNOISE, des sommes dues par la SARL MARINE AZUR, dans la limite de 48.000 euros et pour une durée de 10 années ;
Par un jugement du tribunal de commerce de CANNES, en date du 19 juin 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SARL MARINE AZUR ;
Le 13 juillet 2016, la BANQUE CANNOISE a régulièrement déclaré sa créance, entre les mains de Maître Didier MARTIN :
- au titre du solde débiteur, exigible et chirographaire, du compte n° 69 02 10 12 12 444 …………………..……………………………. 24.036,86 euros
- au titre d’un prêt, non exigible et chirographaire, d’un montant initial de 29.640 euros …………………………….………………. 22.201,45 euros
- au titre d’un prêt, non exigible et chirographaire, d’un montant initial de 9.725 euros ……………………………………………….. 7.571,93 euros ;
Par une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, du 9 janvier 2017, la BANQUE CANNOISE a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur Alain JOURNET, en sa qualité de caution de la SARL MARINE AZUR, pour une créance évaluée à 25.000 euros ;
La formalité d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été déposée au 1ier bureau des hypothèques de GRASSE le 17/01/2017 ;
Il résulte de l’article L. 622-28 alinéa 3 du Code de commerce et des articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en procédure de sauvegarde, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. En conséquence, l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution (Cour de cassation, chambre commerciale du 08/09/2021, n° 19-25686).
En conséquence, l’action de la BANQUE CANNOISE à l’encontre de Monsieur Alain JOURNET, en sa qualité de caution de la SARL MARINE AZUR, à l’effet d’obtenir un titre exécutoire est donc recevable ;
Toutefois, l’article L. 622-28 alinéa 2 du Code de commerce dispose que » le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté » ;
Monsieur Alain JANET, en sa qualité de caution de la SARL MARINE AZUR, sera donc condamné à payer à la BANQUE CANNOISE, la somme de 48.000, 00 montant maximum de son engagement ;
L’exécution de la présente condamnation étant suspendue jusqu’au jour de l’exigibilité de la créance, à savoir :
- le prononcé de la liquidation judiciaire,
- le non-respect du plan adopté ;
Etant précisé que les intérêts légaux seront dus qu’à compter qu’au de l’exigibilité de la créance » ;*
2 – La période du plan de sauvegarde ou de redressement
L’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement modifie le régime applicable aux poursuites dirigées contre les cautions. Il convient de distinguer selon que la caution est une personne physique ou une personne morale et d’envisager la question des mesures conservatoires, ainsi que les conséquences du respect ou du non-respect du plan.
2.1 – Principe : interdiction des poursuites contre les cautions personnes physiques
L’article L. 626-11 du Code de commerce, applicable en sauvegarde, et l’article L. 631-20 du Code de commerce, applicable en redressement judiciaire, prévoient que le jugement arrêtant le plan suspend toute action en paiement contre les cautions personnes physiques.
Autrement dit, tant que le plan est régulièrement exécuté, le créancier ne peut engager ni poursuivre une action en paiement contre la caution personne physique. Cette protection, qui prolonge celle instaurée pendant la période d’observation, vise à favoriser la réussite du plan sans pression indirecte exercée par le biais de la caution.
Il en résulte que la caution personne physique bénéficie d’une suspension de toute action du créancier jusqu’au terme du plan, sauf en cas de résolution de celui-ci.
2.2 – Absence de protection pour les cautions personnes morales
La protection prévue par les articles L. 626-11 et L. 631-20 du Code de commerce est strictement limitée aux cautions personnes physiques.
Les cautions personnes morales (par exemple, une société mère qui s’est portée caution pour sa filiale) ne bénéficient d’aucune suspension et demeurent exposées aux poursuites du créancier pendant toute la durée du plan.
En pratique, le créancier pourra donc obtenir une condamnation et en poursuivre l’exécution immédiatement contre une caution personne morale, même si le débiteur principal respecte le plan arrêté.
2.3 – Les mesures conservatoires pendant le plan
La question se pose de savoir si le créancier peut maintenir ou prendre des mesures conservatoires contre une caution personne physique alors que le plan est en cours d’exécution.
La solution dégagée par la jurisprudence, notamment par la Cour de cassation, chambre commerciale, dans ses arrêts du 21 octobre 2020 (n° 19-16185), du 8 septembre 2021 (n° 19-25686) et du 5 mars 2025 (n° 23-20.357), est la suivante :
Le créancier peut prendre des mesures conservatoires contre les biens de la caution personne physique, même pendant l’exécution du plan.
Conformément à l’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution, il doit introduire, dans le délai d’un mois, une action en vue d’obtenir un titre exécutoire, faute de quoi la mesure conservatoire devient caduque.
Toutefois, l’exécution forcée de ce titre demeure suspendue tant que la créance n’est pas exigible à l’égard de la caution, c’est-à-dire tant que le plan est respecté.
Ainsi, le créancier peut préserver ses droits par une mesure conservatoire et obtenir un titre exécutoire, mais il ne peut en poursuivre l’exécution qu’en cas de résolution du plan.
2.4 – Les conséquences du non-respect du plan
En cas de non-respect du plan, qu’il s’agisse d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, la conséquence est la résolution du plan par le tribunal.
Dès lors, les créances redeviennent immédiatement exigibles et les créanciers retrouvent la possibilité de poursuivre la caution.
Les mesures conservatoires déjà prises deviennent alors pleinement exécutoires et le créancier peut procéder à leur mise en œuvre.
Il en résulte que la caution, jusque-là protégée, redevient redevable de son engagement.
2.5 – Les conséquences du respect intégral du plan
Lorsque le plan est exécuté dans son intégralité et que le débiteur est libéré de ses dettes, la caution bénéficie de la même libération.
Ainsi, la caution n’est plus exposée à aucune action du créancier et son engagement prend fin avec la réalisation complète du plan.
2.6 – Portée pratique
Le régime applicable pendant l’exécution du plan repose sur un équilibre entre deux impératifs :
protéger la caution personne physique, afin de ne pas compromettre les chances de succès du plan ;
préserver les droits du créancier, qui peut prendre des mesures conservatoires et obtenir un titre exécutoire pour sécuriser sa créance, mais dont l’exécution demeure suspendue.
En revanche, les cautions personnes morales restent pleinement exposées aux poursuites, ce qui incite souvent les créanciers à exiger des garanties de sociétés liées au débiteur.
Enfin, la distinction entre le respect intégral du plan (libération définitive de la caution) et son inexécution (exigibilité immédiate de l’engagement de la caution) est déterminante pour le juge saisi.
3 – La liquidation judiciaire
3.1 – Principe général
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire entraîne en principe l’exigibilité immédiate des créances non échues (article L. 643-1 du Code de commerce).
Dès ce jugement, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite contre les cautions, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. La suspension instaurée pendant la période d’observation et l’exécution du plan cesse de produire effet.
3.2 – La prescription de l’action contre la caution
La déclaration de créance interrompt et suspend la prescription pendant toute la durée de la procédure collective (article L. 622-25 du Code de commerce).
À la clôture de la procédure, le délai de prescription quinquennale recommence à courir intégralement.
En cas de plan ultérieurement résolu pour inexécution, une difficulté pratique se pose :
Le point de départ de la prescription est fixé à la date de l’échéance impayée devenue exigible, même si le créancier n’a pas été immédiatement informé du défaut de paiement.
Cette solution impose au créancier une vigilance accrue pour surveiller l’exécution du plan.
3.3 – L’exigibilité des créances selon leur nature
Compte courant bancaire.
Conformément à l’article L. 641-11-1 du Code de commerce, l’ouverture de la liquidation judiciaire n’entraîne pas par elle-même la clôture du compte courant. Celui-ci est considéré comme un contrat en cours et se poursuit jusqu’à sa résiliation.
Le solde n’est donc exigible qu’au jour de la clôture effective du compte par la banque. Tant que cette clôture n’est pas intervenue, aucune action ne peut être valablement dirigée contre la caution.
Prêt à terme.
L’ouverture de la liquidation emporte déchéance du terme : l’intégralité des échéances non encore échues devient immédiatement exigible. Le créancier peut donc agir contre la caution pour le remboursement total du prêt, sous réserve d’une déclaration régulière de la créance.
3.4 – Le recours de la caution contre le débiteur
En cas de paiement effectué par la caution, celle-ci est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal (article 2309 du Code civil).
En pratique, ce recours est dépourvu d’efficacité lorsque le débiteur principal est une société, car la liquidation judiciaire entraîne sa dissolution de plein droit à la clôture de la procédure (article 1844-7, 7° du Code civil).
Le recours subrogatoire de la caution reste donc théorique : il n’offre aucune perspective réelle de recouvrement.
4 – Les conditions à remplir par le créancier pour agir contre la caution
4.1 – Nécessité d’une déclaration de créance
Pour préserver ses droits contre la caution, le créancier doit impérativement avoir déclaré sa créance au passif du débiteur principal.
À défaut de déclaration, aucune action en paiement ne peut être dirigée contre la caution.
4.2 – La situation d’une créance contestée ou non définitivement admise
Le créancier peut poursuivre la caution même si sa créance n’a pas encore été définitivement admise par le juge-commissaire.
Dans ce cas, le tribunal saisi de l’action contre la caution statue comme dans un contentieux ordinaire : il apprécie l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance, sans être lié par la procédure d’admission.
4.3 – La contestation par la caution d’une créance admise
La caution conserve le droit de contester la créance, même si elle a été admise au passif du débiteur principal.
En effet, le nouvel article L. 624-3-1 du Code de commerce précise que l’état des créances n’est pas opposable à la caution lorsqu’il ne lui a pas été notifié.
Ainsi, la caution peut soulever toute contestation utile devant le juge saisi de l’action en paiement, sauf si elle a été régulièrement appelée à la procédure d’admission.
4.4 – Portée pratique
Le créancier doit veiller à déclarer sa créance et à produire, dans le procès contre la caution, les pièces justifiant de cette déclaration.
Le juge consulaire doit vérifier si l’état des créances a été notifié à la caution :
Oui → l’admission devient opposable.
Non → la caution conserve la faculté de discuter la créance comme dans un litige ordinaire.