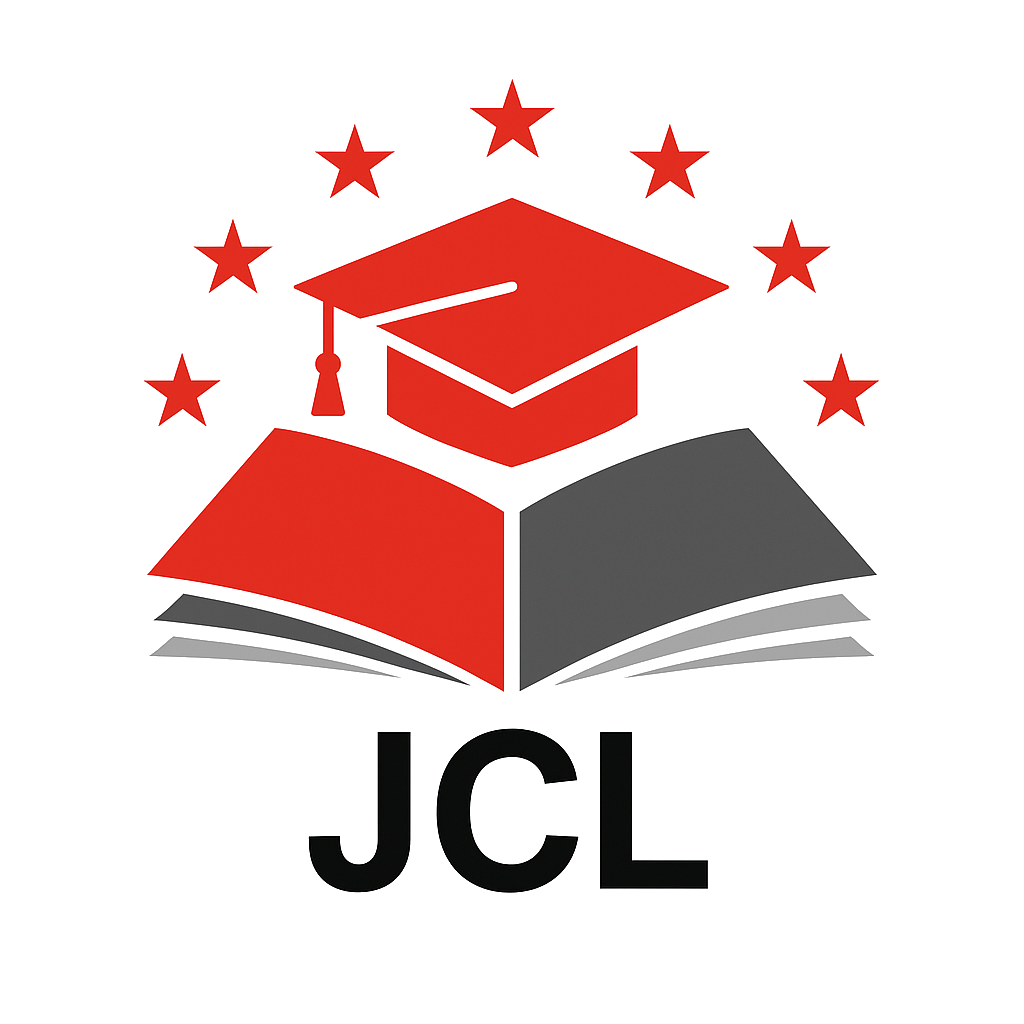Cautionnement : l'extinction
(Par voie accessoire et principale - La subrogation et l'article 2314 du Code civil)
- 1. – Les causes d’extinction
-
2. – Extinction du cautionnement par voie accessoire
- 2.1 – Le paiement (article 1342 à 1346-5 du Code civil).
- 2.2 – La dation en paiement (article 1342-4)
- 2.3 – La novation (articles 1329 à 1335 du Code civil)
- 2.4 – La remise de dette consentie par le créancier (article 1350 à 1350-2 du Code civil)
- 2.5 – La compensation (articles 1347-1 à 1347-7 du Code civil)
- 2.6 – La confusion
- 2.7 – Changement de structure de la société créancière ou débitrice
- 2.8 – Cession de créance, de dette et de contrat
- 2.9 – La prescription
- 2.10 – Portée de l’absence de déclaration de la créance par le créancier
- 3. – Extinction du cautionnement par voie principale
- 4 – Le bénéfice de subrogation (article 2314 du Code civil)
- Principe général : le cautionnement s’éteint par les mêmes causes que l’obligation principale (article 2313 du Code civil), mais aussi par des causes propres aux rapports caution/ créancier.
- Voie accessoire : disparition de la dette principale (paiement, novation, remise de dette, compensation, confusion, etc.) → extinction automatique du cautionnement.
- Voie principale : extinction résultant directement des rapports entre caution et créancier (paiement par la caution, remise de dette consentie à la caution, clause de limitation du droit de poursuite, etc.).
- Dettes futures : – avant 2022, seule la caution donnée à un créancier professionnel devait comporter un montant maximum ; – depuis 2022, tout cautionnement par une personne physique doit comporter un plafond, à peine de nullité (article 2297 du Code civil).
- Couverture vs règlement : la couverture fixe l’étendue des dettes garanties ; le règlement oblige la caution à payer même après la fin de la couverture, pour les dettes nées avant.
- Bénéfice de subrogation (article 2314 du Code civil) : la caution est déchargée si, par la faute du créancier (exemple : omission de déclaration de créance, perte d’une sûreté), elle ne peut plus exercer son recours contre le débiteur.
- Prescription : en principe 5 ans (article 2224 du Code civil), sauf application de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation pour les cautions de consommateurs.
1. – Les causes d’extinction
Le cautionnement peut s’éteindre de deux manières :
par voie accessoire, lorsque la cause d’extinction découle de la relation entre le créancier et le débiteur principal (ex. : paiement de la dette principale) ;
par voie principale, lorsque l’extinction trouve son origine dans les rapports entre la caution et le créancier (ex. : remise de dette à la caution).
L’article 2313 du Code civil consacre cette logique :
« L’obligation s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par la suite de l’extinction de l’obligation garantie. »
À côté de ces principes, la loi prévoit un mécanisme spécifique qui peut également libérer la caution : le bénéfice de subrogation. En application de l’article 2314 du Code civil, la caution est déchargée si, par le fait du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans ses droits.
2. – Extinction du cautionnement par voie accessoire
2.1 – Le paiement (article 1342 à 1346-5 du Code civil).
Le paiement constitue la principale cause d’extinction des obligations. La caution est libérée lorsque le débiteur principal règle sa dette, sous réserve de deux conditions :
le paiement doit être libératoire, c’est-à-dire satisfaire intégralement le créancier ;
il doit être effectué par le débiteur principal lui-même. Si un tiers paye à sa place, ce tiers est subrogé dans les droits du créancier et peut, à son tour, agir contre la caution.
2.1.1 – Règles d’imputation du paiement (article 2313 du Code civil)
2.1.1.1 – Paiement partiel
Selon l’article 1343-1 du Code civil, tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. Cette règle, non impérative, peut être écartée par une stipulation contractuelle.
2.1.1.2 – Pluralité de dettes
Lorsqu’un débiteur doit deux obligations au même créancier, dont une seule est cautionnée :
en l’absence de précision, le paiement s’impute sur la dette que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter (article 1342-10 du Code civil). La jurisprudence considère généralement qu’il s’agit de la dette cautionnée ;
en cas de paiement partiel, celui-ci s’impute d’abord sur la partie non cautionnée de l’obligation, ce qui est la solution la plus favorable au créancier.
2.2 – La dation en paiement (article 1342-4)
La dation en paiement est un mode d’extinction des obligations par lequel le créancier accepte, à la place de la prestation initialement prévue, une chose différente.
2.3 – La novation (articles 1329 à 1335 du Code civil)
L’article 1329 du Code civil définit la novation comme le contrat qui éteint une obligation ancienne en la remplaçant par une obligation nouvelle.
Elle peut intervenir de trois manières :
par substitution d’une obligation à une autre entre les mêmes parties,
par changement de débiteur,
ou par changement de créancier.

En pratique, deux conditions doivent être réunies :
un élément objectif (modification de l’objet ou des parties au rapport d’obligation),
un élément subjectif (volonté expresse d’éteindre l’ancienne obligation).

2.4 – La remise de dette consentie par le créancier (article 1350 à 1350-2 du Code civil)
L’article 1350-2 dispose :
« La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, mêmes solidaires.
La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part. »


2.5 – La compensation (articles 1347-1 à 1347-7 du Code civil)
2.5.1 – Compensation légale
La compensation permet d’éteindre simultanément deux dettes réciproques. Elle opère automatiquement lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre, à hauteur du montant le plus faible.

La compensation légale suppose que les créances soient certaines, liquides, exigibles et fongibles (article 1347-1 du Code civil). Elle produit effet dès que ces conditions sont réunies, à condition d’être invoquée.
2.5.2 – Compensation judiciaire
Le juge peut prononcer la compensation lorsque les créances sont connexes, même si elles ne remplissent pas toutes les conditions de la compensation légale.

Dès lors que les dettes sont connexes, leur compensation peut être immédiatement prononcée ; le juge n’est pas tenu de vérifier la liquidité et l’exigibilité de ces dettes.
Jusqu’au 31 décembre 2021, le créancier pouvait être condamné à verser des dommages et intérêts en cas de manquement à l’obligation de mise en garde. Généralement, le juge ordonnait que cette condamnation soit compensée avec celle prononcée au titre de l’engagement de cautionnement.
2.5.3 – La compensation en matière de procédure collective
En principe, l’ouverture d’une procédure collective interdit le paiement des créances antérieures (article L. 622-7 du Code de commerce).

Cependant, si le créancier n’a pas régulièrement déclaré sa créance, la compensation est sans effet : sa créance est alors inopposable à la procédure.

2.6 – La confusion
La confusion se produit lorsque la qualité de créancier et celle de débiteur se trouvent réunies dans une même personne.
L’article 1349-1 du Code civil prévoit que, si la confusion concerne une obligation garantie par un cautionnement, la caution — même solidaire — est libérée de plein droit.
2.7 – Changement de structure de la société créancière ou débitrice
2.7.1 – Changements de structure sans création de personne morale nouvelle
Un simple changement de forme juridique de la société débitrice ou créancière n’entraîne pas novation, puisqu’il ne crée pas de personne morale nouvelle.

2.7.2 – Changement de structure donnant naissance à une personne morale nouvelle
L’article 2318 du Code civil prévoit :
« En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l’effet d’une fusion, d’une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l’article 1844-5 (transmission universelle), la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l’opération ne soit devenue opposable aux tiers. Elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l’occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance. »

2.8 – Cession de créance, de dette et de contrat
2.8.1 – Cession de créance
La cession d’une créance entraîne la transmission de ses accessoires, dont le cautionnement (article 1321 alinéa 3 du Code civil).


2.8.2 – Cession de dette
La cession de dette permet à un débiteur, avec l’accord du créancier, de transférer sa dette à un tiers (articles 1327 et s. du Code civil).
Deux hypothèses :
si le créancier ne libère pas le débiteur initial, celui-ci reste tenu solidairement et les sûretés, y compris le cautionnement, subsistent ;
si le créancier libère le débiteur initial, les sûretés consenties (notamment le cautionnement) ne subsistent que si la caution ou le débiteur y consentent expressément.
2.8.3 – Cession du contrat
La cession de contrat permet à une partie (le cédant) de transférer l’ensemble de sa relation contractuelle à un tiers (le cessionnaire), avec l’accord de l’autre partie (le cédé) – article 1216 du Code civil.
Si le cédé consent expressément à la cession, le cédant est libéré pour l’avenir.
À défaut, le cédant reste tenu solidairement à l’exécution du contrat (article 1216-1).

2.9 – La prescription
En matière de crédit conclu entre professionnels, l’action du créancier se prescrit par cinq ans (article 2224 du Code civil) :
pour chaque échéance impayée : à compter de sa date d’exigibilité,
pour le capital restant dû : à compter du prononcé de la déchéance du terme.

2.9.1 – Application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation
L’article L. 218-2 dispose :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Si le prêt est consenti à une société (non consommateur), la caution ne peut pas s’en prévaloir.
Dans ce cas, c’est la prescription quinquennale qui s’applique (articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil).

2.10 – Portée de l’absence de déclaration de la créance par le créancier
Dans le cadre d’une procédure collective, chaque créancier doit déclarer sa créance au mandataire ou au liquidateur judiciaire. À défaut, et sauf relevé de forclusion, il est privé du droit de participer aux répartitions.

Pendant l’exécution d’un plan (sauvegarde ou redressement) :
l’article L. 622-26 alinéa 2 du Code de commerce rend la créance non déclarée inopposable au débiteur et à la caution personne physique, tant que le plan est respecté ;
En cas de liquidation judiciaire :
la règle est différente : le créancier négligent conserve ses droits contre la caution, malgré l’absence de déclaration ;
Action fondée sur la subrogation (article 2314 C. civ.) :
même si la caution n’est pas automatiquement libérée, elle peut invoquer la négligence du créancier. En effet, privée du bénéfice de subrogation, elle peut demander sa décharge.
3. – Extinction du cautionnement par voie principale
L’extinction par voie principale peut concerner :
les dettes présentes, déjà existantes lors de la conclusion du cautionnement ;
les dettes futures, qui naîtront ultérieurement (v. infra 3.2).
3.1 – L’extinction du cautionnement de dettes présentes
3.1.1 – Paiement par la caution
Lorsque la caution règle le créancier, son engagement s’éteint, à condition que le paiement soit valable, effectif et intégral.
Règles particulières :
en cas de paiement partiel, celui-ci s’impute d’abord sur les intérêts, puis sur le capital (article 1343-1 C. civ.) ;
si plusieurs dettes sont garanties par le même créancier, la caution peut indiquer laquelle elle entend acquitter (article 1342-10 C. civ.).
3.1.2 – Remise de dette
Le créancier peut accorder une remise partielle ou totale à la caution.
L’article 1350-2 du Code civil précise :
« La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part. »

Exemple d’application de l’article 1350-2 du Code civil
Un créancier titulaire d’une créance de 100.000 € bénéficie de quatre cautions :
- A pour 30.000 €
- B pour 50.000 €
- C pour 80.000 €
D pour 100.000 €
Calcul de la part contributive initiale
Pour déterminer la part contributive de chaque caution, on compare le montant maximum de son engagement à la somme totale des engagements (soit 30.000 + 50.000 + 80.000 + 100.000 = 260.000 €).
- A : 30.000 ÷ 260.000 = 11,5 % → 11.500 €
- B : 50.000 ÷ 260.000 = 19,2 % → 19.200 €
- C : 80.000 ÷ 260.000 = 30,8 % → 30.800 €
D : 100.000 ÷ 260.000 = 38,5 % → 38.500 €
Le créancier consent une remise totale à C.
En application de l’article 1350-2 du Code civil, cette remise ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres cautions à concurrence de la part de C.
Le montant garanti par les cautions passe donc de 100.000 € à 69.200 € (100.000 – la part de C 30.800).
Droits du créancier et répartition entre cautions
Le créancier, en leur qualité de cautions solidaires, peut réclamer à A, B ou D l’intégralité de ce solde (69.200 €).
Mais en cas de recours entre cautions, la répartition contributive s’opère désormais entre A, B et D seulement, sur la base de leurs plafonds respectifs (30.000 + 50.000 + 100.000 = 180.000 €) :
- A : 30.000 ÷ 180.000 = 16,67 % → 11.536 €
- B : 50.000 ÷ 180.000 = 27,78 % → 19.224 €
- D : 100.000 ÷ 180.000 = 55,55 % → 38.440 €
3.1.3 Limitation du droit de poursuite du créancier dans le temps
Deux situations doivent être distinguées :
Fin de la couverture :
La fixation d’une date limite dans l’acte de cautionnement met fin à l’obligation de couverture, mais reste sans incidence sur l’obligation de règlement.Ainsi, la caution demeure tenue des dettes nées avant cette date, même si elles deviennent exigibles ultérieurement (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-23850).
Clause limitative de poursuite :
Une clause peut restreindre le délai pendant lequel le créancier peut agir contre la caution après la fin de l’engagement.Ce délai est un délai de forclusion (et non de prescription).
L’article 2254 du Code civil admet la validité de telles clauses, à condition qu’elles ne prévoient pas un délai inférieur à un an.
L’article 2319 du Code civil illustre cette logique en disposant que :
« La caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement. »
Exemple pratique :
Une caution s’engage pour 100.000 € jusqu’au 31 décembre 2030.
Sans clause particulière : le créancier peut agir dans le délai de prescription de droit commun (5 ans).
Avec clause limitative de 2 ans : l’action doit être engagée avant le 31 décembre 2032.
Exemples de rédaction de clauses :
- « L’engagement de la caution est assorti d’un délai de poursuite de deux ans à compter de l’échéance du cautionnement. À défaut d’action dans ce délai, toute demande du créancier sera forclose. »
- « Le cautionnement couvre les dettes nées entre la date de souscription et le 31 décembre 2030 ; la caution ne sera tenue qu’au titre des dettes nées durant cette période. Le créancier s’interdit d’engager une action contre la caution au-delà de deux ans après l’échéance de l’obligation de couverture. »


Dans le cas d’un prêt à remboursement échelonné, chaque échéance constitue une dette distincte :
- Les échéances nées avant la date limite du cautionnement restent couvertes par la caution, même si elles deviennent exigibles après cette date.
- Les échéances nées après la date limite du cautionnement ne sont pas couvertes, car la caution ne garantit que les dettes nées pendant la durée de son engagement.
La situation est différente lorsque le prêteur prononce la déchéance du terme :
- Si la déchéance du terme est intervenue avant la date limite du cautionnement, la caution est tenue de l’intégralité du capital restant dû.
- Si la déchéance du terme est intervenue après la date limite du cautionnement, la caution n’est tenue que des échéances déjà nées avant cette date, et non du capital restant dû dans son ensemble.
Enfin, chacune de ces dettes est soumise à la prescription de cinq années prévue à l’article 2224 du Code civil. Le créancier dispose donc de cinq années à compter de l’exigibilité de chaque échéance pour agir contre la caution, sauf clause contractuelle expresse réduisant ce délai.

la déchéance du terme et une éventuelle clause de limitation du délai de poursuite
peut modifier de manière décisive l’étendue des obligations de la caution et la période pendant laquelle le créancier peut valablement agir.
3.2 – L’extinction du cautionnement de dettes futures
Le cautionnement de dettes futures a pour objet de garantir des dettes qui ne sont pas encore nées au moment de la souscription. On le rencontre souvent dans les relations de crédit, lorsqu’une caution garantit les dettes à venir d’un débiteur.

pour les créanciers professionnels, l’acte devait comporter un montant maximum (anciens articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation) ;
pour les créanciers non professionnels, cette exigence ne s’appliquait pas : un cautionnement pouvait donc être valable même sans plafond.

L’article 2297 du Code civil impose, à peine de nullité, que tout cautionnement souscrit par une personne physique mentionne un montant maximum en principal et accessoires, rédigé en lettres et en chiffres, quel que soit le type de créancier (professionnel ou non).
Couverture et règlement : une distinction essentielle
Obligation de couverture : elle fixe la période et l’étendue des dettes garanties.
Exemple : si la caution s’engage pour toutes les dettes de X jusqu’au 31 décembre 2030, seules les dettes nées avant cette date sont couvertes.
Obligation de règlement : elle oblige la caution à payer les dettes couvertes, même si elles deviennent exigibles après l’expiration de la couverture.
Exemple : une échéance impayée au 30 décembre 2030, exigible en janvier 2031, reste à la charge de la caution.

4 – Le bénéfice de subrogation (article 2314 du Code civil)
L’article 2314 du Code civil dispose :
« Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode réalisation d’une sûreté ».
4.1 – Principe et conditions
Le paiement effectué par la caution entraîne sa subrogation dans les droits du créancier : elle peut ainsi se retourner contre le débiteur principal et bénéficier des garanties attachées à la créance (hypothèques, privilèges, nantissements).
Lorsque le créancier, par sa faute ou sa négligence, prive la caution de cette possibilité, la sanction est la décharge de la caution, totale ou partielle selon l’étendue du préjudice.
L’alinéa 2 dispose que « toute clause contraire est réputée non écrite « , il s’agit donc d’une disposition d’ordre public.
L’action en décharge ne peut être exercée par la caution, que si 3 conditions sont réunies, à savoir :
- perte d’un droit préférentiel, conférant au créancier un avantage particulier,
- par le fait du créancier,
- ayant pour conséquence un préjudice.
Il appartient donc à la caution d’apporter la preuve que ces 3 conditions sont réunies.
Ne peuvent bénéficier de cette décharge les sûretés réelles (hypothèque…).
4.1.1 – Première condition : perte d’un droit préférentiel
Il s’agit de la perte d’un avantage permettant, au créancier, d’échapper aux concours ou d’augmenter ses chances d’être payé. La caution est ainsi déchargée lorsque le créancier n’a pas exercé :
- son droit à revendication d’un matériel en crédit-bail (Cour de cassation, chambre commerciale du 14/02/1995, n° 93-13848) ;
- son droit en matière de vente avec clause de réserve de propriété ( Cour de cassation, chambre commerciale du 24/04/2007, n° 04-13898) ;
- l’action directe contre le maître d’ouvrage (Cour de cassation, chambre commerciale du 14/01/2004, n° 01-13917) ;
- son droit d’agir en résolution du contrat, en particulier concernant le bail commercial (Cour de cassation, chambre commerciale du 03/12/2003, n° 01-14391).
La jurisprudence admet l’application de l’article 2314 du Code civil, en cas d’omission de la déclaration de créance, par le créancier, privant ainsi la caution d’être subrogée dans les droits du créancier, dans le paiement des dividendes (Cour de cassation, chambre commerciale du 12/07/2011, n° 09-71113). La caution doit alors démontrer l’existence d’un préjudice, à savoir l’éventualité de percevoir un dividende ou un paiement par répartition de l’actif.
Voir également de la Cour de cassation, du 21/06/2023, n° 21-23397 et concernant la déclaration par le créancier d’une créance hypothécaire au lieu de privilégié (nantissement sur le fond.
4.1.2 – Deuxième condition : la faute du créancier
La jurisprudence retient, aussi bien la faute volontaire que la faute d’imprudence. Les fautes s’apprécient par référence au comportement exigé du bon père de famille.
La faute peut consister en des actes positifs : le créancier est fautif lorsqu’il accepte une mainlevée prématurée d’hypothèque.
Le fait peut consister également en une abstention : mise en œuvre tardive d’un nantissement sur le fonds de commerce.
Toutefois, » la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté » : ainsi la caution qui bénéfice à la fois d’un cautionnement et d’une sûreté réelle n’est pas tenu de réaliser sa sûreté réelle avant de poursuivre la caution (Cour de cassation, chambre commerciale du 11/04/2018, n° 16-24947).
Le créancier peut démontrer que la perte du droit est imputable à d’autres personnes que lui. Il peut se prévaloir d’une faute commise par la caution ou le débiteur principal : le débiteur peut par exemple avoir fait disparaitre le véhicule assiette du gage.
4.1.3 – Troisième condition : exigence d’un préjudice
Alors que l’article 2314 du Code civil ne l’impose pas, la jurisprudence exige que la perte du droit ait causé un préjudice à la caution.
Il appartient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d’établir que la perte d’un droit préférentiel a causé à celle-ci un préjudice inférieur au montant de son engagement ou ne lui en a causé aucun (Cour de cassation, chambre commerciale du 08/04/2015, n° 13-22969)
4.2 – Effet du bénéfice de subrogation : une décharge mesurée
La décharge de la caution n’est pas automatique : elle suppose un préjudice.
La sanction est proportionnée : la caution n’est libérée qu’à hauteur du » préjudice subi « , comme le confirme l’article 2314 du Code civil.


4.2.1 Un exemple de jugement
Cour d’appel de PARIS 5, 6 du 01/03/2023n , n° 21/15626
Préalablement à sa décision, la Cour d’appel de PARIS a repris l’ensemble des faits et prétentions de chaque partie, que nous ne reproduisons pas ici.
… L’article 2314 du code civil dispose que : » La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite « .
Liminairement, il sera rappelé que la caution ne peut être déchargée que si les droits préférentiels existaient antérieurement ou concomitamment à son engagement, ou étaient entrés dans les prévisions de la caution. En l’espèce, le nantissement comme le cautionnement de M. [B] étaient prévus au rang des garanties du contrat de prêt du 7 septembre 2012.
La décharge prévue par l’article 2314 du code civil est soumise à trois conditions qui doivent être cumulativement remplies (et uniquement celles-ci) :
– un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu,
– cette perte doit être intervenue par le fait du créancier,
– la caution doit avoir éprouvé un préjudice.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la perte d’un droit préférentiel c’est à dire un droit susceptible de conférer à son titulaire une faculté plus grande dans la perception de sa créance, ajoutant un avantage à sa situation de chirographaire. À cet égard, encourt la sanction prévue à l’article 2314 du code civil, le créancier qui n’a pas empêché la résiliation du bail commercial, élément essentiel du fonds de commerce nanti, lequel a perdu ainsi toute consistance.
Néanmoins, dans la mesure où la perte du droit doit être intervenue du » fait du créancier « , plus précisément, de par la faute exclusive de celui-ci, la déchéance n’est pas encourue dans l’hypothèse où le créancier nanti sur un fonds de commerce, se voit reprocher par la caution de ne pas avoir payé les loyers dus par le débiteur principal et d’avoir ainsi laisser perdre le nantissement par l’effet de la résiliation du bail : il s’agit d’un fait non fautif, en l’absence d’obligation en ce sens, et compte tenu du fait qu’on ne saurait reprocher au créancier de ne pas avoir accru son propre risque en payant la dette du débiteur. En outre, la décharge doit être refusée lorsque le débiteur, la caution, ou un tiers, porte une part de responsabilité dans la perte du droit préférentiel, tel le débiteur qui a laissé s’accumuler les loyers impayés, ou la caution qui s’est désintéressée de la situation du cautionné.
Cette deuxième condition, selon laquelle la perte du droit doit être intervenue par la faute exclusive du créancier, n’étant pas remplie, et les trois conditions résultant de l’article 2314 du code civil étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner en l’espèce, la question du préjudice qu’aurait subi la caution.
M. [B] sera donc débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 2314 du code civil.
👉 Commentaire pratique :
Cet arrêt illustre parfaitement la rigueur de l’article 2314 du Code civil. Le juge consulaire doit vérifier :
que le droit perdu aurait réellement profité à la caution,
que la perte résulte exclusivement de la faute du créancier,
et qu’un préjudice en découle.
En pratique, la décharge n’est pas automatique : elle est refusée si le créancier n’a pas commis de faute caractérisée (par exemple, il n’a pas à payer à la place du débiteur pour sauver une sûreté).