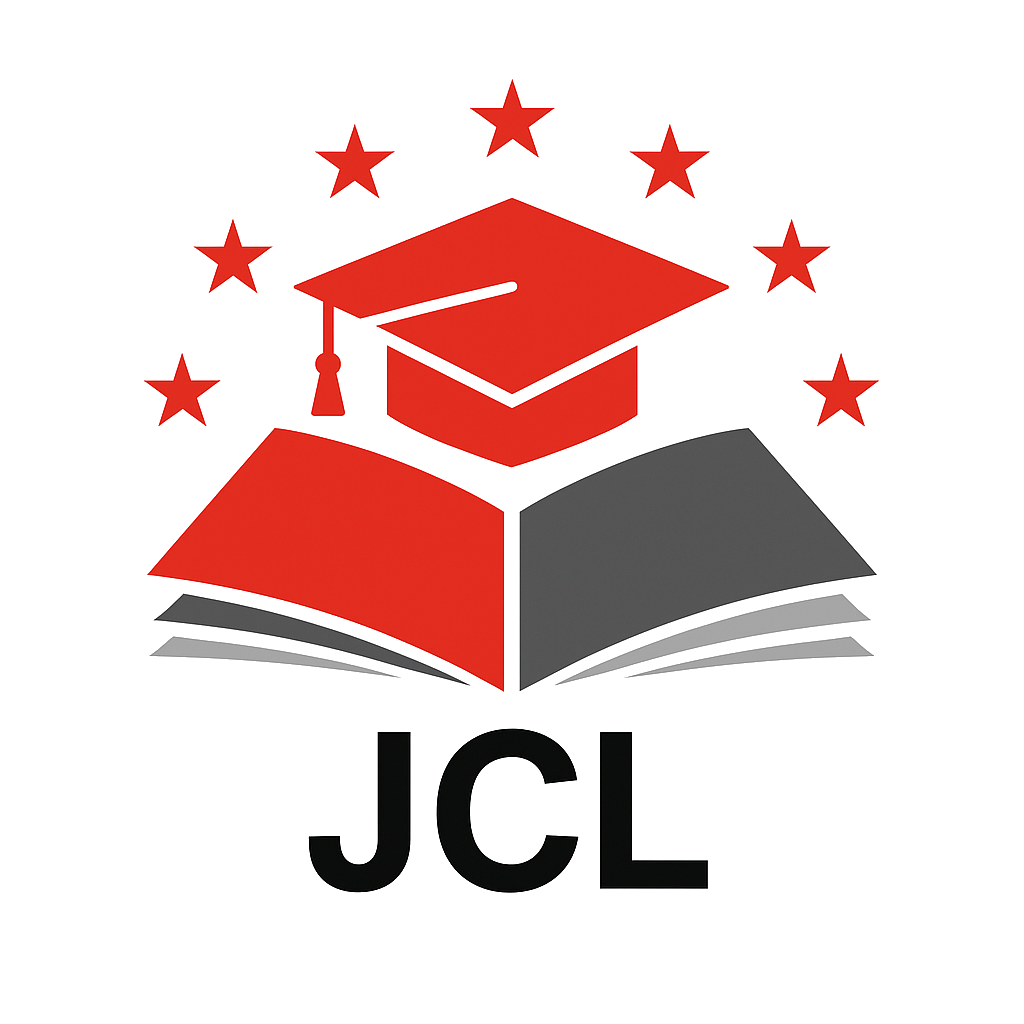Fait générateur de la créance - Auteur, destinataire et contenu de la déclaration de créance
- PREMIERE PARTIE - FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE
- 1. – Créances concernées par la déclaration – Principe de l’antériorité de la créance.
-
2. – Notion de fait générateur
-
2.1 – Fait générateur d’une créance d’origine contractuelle
- 2.1.1 – Fait générateur d’un contrat à exécution instantanée
- 2.1.2 – Fait générateur d’un contrat à exécutions successives
-
2.1.3 – Autres cas
- 2.1.3.1 – Fait générateur d’une créance née de la mauvaise exécution d’un contrat
- 2.1.3.2 – Fait générateur d’une créance née de la garantie des vices cachés ou la garantie d’un défaut de conformité de la chose vendue.
- 2.1.3.3 – Fait générateur d’une créance née de l’annulation ou la caducité du contrat.
- 2.1.3.4 – Fait générateur d’une créance née de la résiliation ou de la résolution d’un contrat.
- 2.2 – Fait générateur d’une créance d’origine extracontractuelle
- 2.3 – Fait générateur de la créance fiscale et sociale
-
2.1 – Fait générateur d’une créance d’origine contractuelle
- DEUXIEME PARTIE - AUTEUR ET DESTINATAIRE DE LA DECLARATION DE CREANCE
-
1. – Auteur de la déclaration de créance
-
1.1 – Déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier
- 1.1.1 – NOTE IMPORTANTE – Toute déclaration faite par le débiteur est annulée par une déclaration effectuée par le créancier lui-même.
- 1.1.2 – Quand et comment le débiteur peut effectuer la déclaration de créance pour le compte du créancier,
- 1.1.3 – Quelles mentions le débiteur doit porter sur la liste des créanciers pour la créance soit admise par le mandataire judiciaire
- 1.1.4 – Contestation par le créancier du montant de la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire
- 1.1.5 – Contestation par le débiteur de la créance qu’il a lui-même déclarée
- 1.2 – Déclaration de créance effectuée par une personne ne disposant pas de pouvoir
- 1.3 – Déclaration effectuée par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
-
1.1 – Déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier
- 2. – Destinataire de la déclaration de créance
- TROISIEME PARTIE : CONTENU DE LA DECLARATION DE CREANCE
-
1. – Contenu de la déclaration de créance
- 1.1 – Règles générales.
-
1.2 – Montant de la déclaration de créances.
- 1.2.1 – Interdiction de principe des déclarations de créances à titre provisionnel.
- 1.2.2 – La particularité des déclarations de créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité : déclaration à titre provisionnel
- 1.2.3 – La déclaration des intérêts.
- 1.2.4 – La déclaration de l’indemnité d’exigibilité anticipée
- 1.2.5 – Indemnité de recouvrement
- 1.2.6 – L’indemnité de résiliation d’un contrat à exécutions successives
- 1.2.7 – La déclaration des sûretés
- 1.2.8 – Déclaration des créances non exigibles
- 1.2.9 – Déclaration du compte bancaire non clôturé
- 2. – Le sort des créances non déclarées et créances rejetées.
PREMIERE PARTIE - FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE
1. – Créances concernées par la déclaration – Principe de l’antériorité de la créance.
Article L. 622-24 :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ».
Nous verrons qu’il existe une exception, concernant le délai de déclaration de créances, qui s’applique à l’indemnité de résiliation d’un contrat antérieur l’ouverture de la procédure collective et pour lequel sa résiliation et prononcée pendant la période d’observation.
Précisons que, si le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur une créance née régulièrement après l’ouverture de la procédure collective, il est toutefois compétent pour délimiter de la nature antérieure ou postérieure d’une créance (Cour de cassation chambre commerciale du 28/04/2004 n° 01-01649).
2. – Notion de fait générateur
Il apparaît nécessaire d’apporter quelques précisions concernant la notion de « créance née antérieurement au jugement d’ouverture » ou comme l’indiquait la législation antérieure à la loi de sauvegarde « dont l’origine » est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Rappelons à titre préliminaire, que le fait générateur d’une créance est totalement indépendant de son exigibilité.
L’étude du fait générateur d’une créance nous oblige à faire une distinction entre :
- une créance contractuelle (en effectuant la distinction entre un contrat instantané et un contrat à exécutions successives),
- une créance extracontractuelle,
- et une créance fiscale et sociale.
2.1 – Fait générateur d’une créance d’origine contractuelle
2.1.1 – Fait générateur d’un contrat à exécution instantanée
2.1.1.1 – Le contrat de vente
Dans le contrat de vente, l’obligation essentielle du vendeur est la délivrance de la chose. Pour l’acheteur, son obligation est de payer le prix, en contrepartie de la délivrance de ladite chose.
Le fait générateur pour l’acheteur de son obligation de payer est donc constitué par la délivrance de la chose. La « délivrance » étant l’opération juridique par laquelle, indépendamment de l’opération purement matérielle, une personne transfère un bien ou un droit à une autre (voir l’article 1605 pour un bien immeuble et l’article 1606 pour un bien meuble).
Quelques exemples de délivrance :
- Lorsque pour des raisons évidentes et pratiques, l’acheteur ne peut pas immédiatement retirer la chose (cas de vente de choses difficilement transportables), le vendeur exécute son obligation de délivrance en mettant cette chose à sa disposition. En l’absence de clauses contractuelles spécifiques, il n’existe pas d’obligation pour le vendeur d’assurer la livraison de la chose vendue.
A rempli son obligation de délivrance le vendeur qui a remis les marchandises vendues au transporteur qui les a acceptées sans réserve. - La délivrance de la de vente de matériaux non encore extraits,s’opère au jour où plus rien ne s’oppose, du fait du vendeur, à ce que l’acquéreur commence l’exploitation.
- L’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue.
Il en résulte, que la créance du prix de vente est, une créance antérieure au jugement d’ouverture que si la délivrance intervient avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
La notion délivrance de la chose doit donc être examinée au regard de l’accord des parties (Cour de cassation chambre commerciale du 03/04/2001 n° 98-14049).
Notons que :
- La déclaration irrégulière d’une créance postérieure ne peut entraîner son extinction, dès lors qu’elle n’avait pas à être déclarée (Cour de cassation, chambre commerciale du 12/01/2010, n° 08-21456), elle conserve donc sa qualification de créance postérieure, avec tous les effets que cela comporte.
- La décision d’admission d’une créance au passif ayant autorité de la chose jugée quant à la date de naissance de la créance déclarée, ne peut plus être contestée (Cour de cassation, chambre commerciale du 03/05/2011, n° 10-18031).
Concernant le contrat de vente notons également :
- Le fait que la vente soit assortie d’une clause de réserve de propriété ne modifie pas la solution.
- Dans la vente avec rente viagère, les rentes échues après le jugement d’ouverture sont des créances antérieures, dès lors que le transfert de propriété de l’immeuble est intervenu avant le jugement d’ouverture.
2.1.1.2 – Le contrat de prêt
En l’état actuel de la jurisprudence, le fait générateur d’un contrat de prêt se situe au jour de la date de conclusion du contrat ou de l’acceptation de l’offre préalable, s’il s’agit d’un prêt consenti par un établissement de crédit.
En présence d’une ouverture de crédit, qui s’analyse en un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client de la banque, seule la fraction de l’ouverture de crédit utilisée avant le jugement d’ouverture est une créance antérieure.
2.1.2 – Fait générateur d’un contrat à exécutions successives
2.1.2.1 – En matière de bail (crédit-bail et location financière).
L’obligation essentielle du bailleur, est de procurer au locataire la jouissance du bien loué.
C’est donc la jouissance qui constitue le fait générateur du loyer. Elle se renouvelle dans le temps et a pour la durée le temps du bail.
En conséquence, la créance de loyers due pour la période de jouissance postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire, constitue une créance née régulièrement après ce jugement, qui n’a pas à être déclarée au titre des créances antérieures et donc à être comprise dans un plan de sauvegarde ou redressement.
Elle constitue par contre une créance postérieure, éventuellement prioritaire (Cour de cassation, chambre commerciale du 12/01/2010, n° 08-21456).
En présence d’un bail conclu avant le jugement d’ouverture, il est donc possible d’être titulaire, à la fois, d’une créance antérieure et d’une créance postérieure au jugement d’ouverture.
Le loyer « à cheval » sur une période antérieure et postérieure au jugement d’ouverture, doit donc être fractionné en deux créances distinctes, l’une antérieure, l’autre postérieure.
Si la dette de loyer est exigible avant jugement d’ouverture, mais qu’elle correspond à une période de jouissance postérieure au jugement d’ouverture, elle constitue une dette postérieure (Cour de cassation, chambre commerciale du 28/05/2002, n° 99-19766).
Les accessoires d’une créance de loyers auront la même nature.
2.1.2.2 – Créance née d’une mission confiée à un professionnel
Dans un contrat portant sur une prestation de service à exécution successive, si la prestation est fournie avant le jugement d’ouverture, elle fait naître une créance antérieure. Si elle est fournie après le jugement d’ouverture, elle fait naître une créance postérieure.
Par exemple, la créance d’honoraires d’un commissaire aux comptes, prend naissance, au fur et à mesure des prestations accomplies (Cour de cassation, chambre commerciale du 02/10/2001, n° 98-22493). Cette solution est également applicable à un expert-comptable.
Concernant l’agent immobilier, la Cour de cassation a jugé que la créance naissait de la conclusion du mandat et non dans la vente (Cour de cassation, chambre commerciale du 17/02/1998, n° 95-15409).
2.1.3 – Autres cas
2.1.3.1 – Fait générateur d’une créance née de la mauvaise exécution d’un contrat
Le fait générateur d’une créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse d’un contrat, trouve son origine dans l’exécution dudit contrat. La créance résultant de malfaçons à son origine non dans le contrat, mais dans l’exécution de la prestation (Cour de cassation, chambre commerciale du 27/09/2017, n° 16-14634).
Il en résulte que la mauvaise exécution d’un contrat, antérieure au jugement d’ouverture, donnera lieu à une créance antérieure au jugement d’ouverture, devant donc être déclarée au passif (Cour de cassation, chambre commerciale du 30/03/2011, n° 09-11805).
Il conviendra donc de rechercher la date à laquelle a été réalisée la prestation arguée de malfaçons.
Le cocontractant du débiteur ne pourra compenser cette créance de dommages et intérêts qu’en la déclarant au passif (Cour de cassation, chambre commerciale du 27/03/2012, n° 11-10147). Un maître d’ouvrage qui refuse de payer la situation d’une entreprise de bâtiment, pour malfaçons, ne pourra effectuer une compensation entre le montant dû et le dommage causé, que s’il a effectué une déclaration de créance.
La solution est identique, concernant la qualification de dette antérieure et postérieure, pour le retard dans l’exécution. Si le retard dans l’exécution est antérieur au jugement d’ouverture, la créance est antérieure, si le retard a lieu après le jugement d’ouverture, la créance à une nature postérieure.
2.1.3.2 – Fait générateur d’une créance née de la garantie des vices cachés ou la garantie d’un défaut de conformité de la chose vendue.
Le fait générateur de la créance de garantie est la conclusion de la vente et non l’apparition du vice caché, ce qui oblige le cocontractant à déclarer au passif sa créance de garantie, pour pouvoir éventuellement la mettre en œuvre après le jugement d’ouverture. Il en est de même de la créance de garantie née d’un défaut de conformité de la chose vendue, qui a son origine dans la conclusion de vente, non dans l’apparition du dommage.
La jurisprudence oblige un créancier titulaire d’une créance de garantie à déclarer celle-ci au passif, alors même que la garantie n’est pas activée.
Cour de cassation chambre commerciale du 18/02/2003, n° 00-13257 :
2.1.3.3 – Fait générateur d’une créance née de l’annulation ou la caducité du contrat.
La créance de restitution née de l’annulation d’un contrat passé avant jugement d’ouverture est une créance postérieure si l’annulation intervient après le jugement d’ouverture, même en cas d’appel (Cour de cassation, chambre commerciale du 02/12/2014, n° 12-27739).
2.1.3.4 – Fait générateur d’une créance née de la résiliation ou de la résolution d’un contrat.
La créance de restitution née de la résiliation d’un contrat conclu avant le jugement d’ouverture est une créance postérieure, dès lors que la résiliation intervient après ledit jugement (Cour de cassation, chambre commerciale du 22/05/2007, n° 06-13978).
Toutefois cette créance, comme la précédente ne pourra bénéficier du traitement préférentiel réservé aux créances postérieures (Cour de cassation, chambre commerciale du 16/12/2014, n° 13-24623).
2.2 – Fait générateur d’une créance d’origine extracontractuelle
2.2.1 – Fait générateur d’une créance de dépens, d’article 700 du Code de procédure civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles de la condamnation à l’article 700 et aux dépens (Cour de cassation, chambre civile 3 du 08/07/2021, n° 19-18437)
Dans l’hypothèse d’un jugement de condamnation postérieur à l’ouverture de la procédure collective, ces condamnations constituent des créances postérieures payables dès la signification du jugement.
Il semblerait que la condamnation à l’article 700 du CPC, pour une assignation postérieure à l’ouverture de la procédure collective (en cas d’absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire) consitue est une créance postérieure, celle-ci ayant pris naissance par le jugement qui la prononce.
2.2.2 – Fait générateur de la créance d’astreinte
Si l’astreinte a été prononcée à l’occasion d’une condamnation antérieure au jugement d’ouverture, c’est une créance antérieure, même si elle est liquidée après le jugement d’ouverture. Elle fait donc partie du plan de sauvegarde ou de redressement, si elle est déclarée et admise.
Si l’astreinte a été prononcée après le jugement d’ouverture, elle fait naître une créance postérieure, qui ne pourra bénéficier d’un traitement préférentiel.
2.2.3 – Fait générateur de la créance d’origine délictuelle
En matière de responsabilité délictuelle, il est jugé que seul importe la date de la faute ou du fait dommageable (Cour de cassation, chambre commerciale du 16/03/2010, n° 09-13937).
2.3 – Fait générateur de la créance fiscale et sociale
2.3.1 – Fait générateur de la créance fiscale
En ce qui concerne les créances fiscales, les textes sont multiples et le fait générateur de la créance d’impôt est différent presque pour chacun des impôts. Il est donc impossible d’en faire une liste exhaustive.
La TVA assise sur des prestations de services a pour fait générateur l’exécution de la prestation, celle assise sur les ventes, la date de livraison.
Le fait générateur de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est l’exercice d’une activité imposable au 1ier janvier de l’année d’imposition.
Le fait générateur de l’impôt sur le revenu résulte de l’expiration de l’année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus (Cour de cassation, chambre commerciale du 14/01/2004, n° 01-03663).
En cas de vérification fiscale, le fait générateur du montant redressé, est constitué par le fait générateur de l’impôt redressé. Exemple : le redressement fiscal du 14/12/2018, concernant une TVA de janvier 2015, le fait générateur sera fixé à janvier 2015.
2.3.2 – Le fait générateur des créances sociales
Les cotisations URSSAF ont pour fait générateur l’accomplissement du travail sur la rémunération duquel elles sont calculées, alors pourtant que leur calcul intervient postérieurement et que leur exigibilité est postérieure.
Si les cotisations se rapportent pour partie à une période de travail antérieure au jugement d’ouverture et pour partie à une période postérieure audit jugement, il convient de scinder en deux fractions la créance de cotisations (voir pour la créance de régularisation).
En ce qui concerne les cotisations de retraite, le fait générateur de la cotisation d’assurance est l’exercice de l’activité au premier jour du trimestre civil.
DEUXIEME PARTIE - AUTEUR ET DESTINATAIRE DE LA DECLARATION DE CREANCE
1. – Auteur de la déclaration de créance
L’inscription d’une créance sur l’état des créances d’un débiteur, a trois origines possibles :
- Créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur) par le débiteur, qui est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration, dans le délai légal des deux mois ;
- Déclaration faite dans les délais, par une personne ne disposant pas des pouvoirs d’effectuer une demande en justice, mais qui aura fait l’objet d’une ratification par le créancier jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, y compris devant la Cour d’appel (2ième phrase de l’alinéa 2 de l’article L. 622-24 du code de commerce),
- La déclaration de créance faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
1.1 – Déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier
Il s’agit ici d’une innovation majeure de l’ordonnance du 12/03/2014, applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 01/07/2014.
Article L. 622-24 alinéa 3 du Code de commerce
« Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa ».
Dans un arrêt du 03/07/2024 (n° 23-15715) la Cour de cassation précise que le débiteur doit déclarer toutes les créances même celles contestées.
Il s’agit de faire jouer, principalement, à la liste des créanciers que le débiteur a l’obligation d’établir et de faire parvenir au mandataire ou liquidateur judiciaire, à l’ouverture de la procédure collective (article L. 622-6 2ième alinéa), un effet de reconnaissance de dette, qui vaut déclaration de créance.
Par cette mention sur la liste, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier et avoir déclaré pour son compte la créance.
Si le créancier déclare personnellement sa créance, dans les délais légaux, cette déclaration se substituera à la déclaration de créance par le débiteur, que cette substitution soit favorable ou non au créancier.
Le 4ième alinéa de l’article R. 622-21 précise de plus, que le mandataire ou le liquidateur judiciaire doit, dans l’avertissement de produire dans les délais, aviser le créancier que le débiteur a porté sa créance à sa connaissance. L’avertissement n’est donc pas supprimé au prétexte que la créance a été portée à la connaissance du mandataire par le débiteur.
Rappelons que l’article L. 653-5 7° prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 (dirigeant de droit ou de fait) contre laquelle a été relevé qu’elle a déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
1.1.1 – NOTE IMPORTANTE – Toute déclaration faite par le débiteur est annulée par une déclaration effectuée par le créancier lui-même.
Toute déclaration faite par le créancier, dans le délai de 2 mois de l’insertion au BODACC de l’ouverture de la procédure collective, a pour conséquence l’annulation pure et simple de toute déclaration faite par le débiteur, dans la mesure où il s’agit de la même créance (pas toujours facile à constater).
1.1.2 – Quand et comment le débiteur peut effectuer la déclaration de créance pour le compte du créancier,
Faut-il en conclure que le débiteur ne peut faire cette déclaration de créance pour le compte du créancier, que par l’intermédiaire de la liste que le débiteur doit remettre au mandataire judiciaire de ses créanciers (article L. 622-6 alinéa 2), dans les 8 jours du jugement d’ouverture (article R. 622-5 alinéa 2).
Cela ne semble pas être le cas, au regard de l’article R. 622-5 alinéa 3, qui indique d’une part qu’il s’agit de « toute déclaration faite par le débiteur » et que d’autre part ladite déclaration peut être faite dans les délais de deux mois de l’insertion au BODACC de l’ouverture de la procédure collective.
Article R. 622-5 alinéa 3 du Code de commerce
« Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l’article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l’article R. 622-23. ».
1.1.3 – Quelles mentions le débiteur doit porter sur la liste des créanciers pour la créance soit admise par le mandataire judiciaire
Quelles sont les mentions que le débiteur doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire ?
Le deuxième alinéa de l’article R. 622-5 répond à cette question :
« Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 622-24, la déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l’article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l’article R. 622-23 ».
Autrement dit, dans le délai de 8 jours à compter de l’ouverture de la procédure (premier alinéa de l’article R. 622-24), le débiteur devra déclarer au mandataire judiciaire, concernant ses créanciers :
- Le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances (article L. 622-25 alinéa 1) ;
- La nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie (article L. 622-25 alinéa 1) ;
- Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture (article L. 622-25 alinéa 2) ;
- Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté (2° de l’article R. 622-23).
Il est à noter que le débiteur n’a aucune justification à produire concernant la créance qu’il déclare pour le compte du créancier. Le mandataire ou le liquidateur judiciaire ne peut donc contester la créance pour absence de justification.
Ainsi, si le mandataire estime non conforme la déclaration faite par le débiteur, il devra considérer que la créance n’a pas été déclarée par le débiteur pour le compte du créancier. Cette position du mandataire judiciaire pourra être contestée, par le jeu d’une demande en relevé de forclusion. Le fait de savoir si la créance a été déclarée pour le compte du créancier relève de l’appréciation du juge-commissaire et non du juge du fond.
Dans cette hypothèse et en l’absence de précision du législateur, le mandataire judiciaire n’aura pas à informer le créancier que sa créance a été portée par le débiteur sur la liste, le créancier devra donc effectuer sa déclaration de créance dans le délai des deux mois.
Mais, dans la pratique, la situation se présente sous des aspects plus complexes.
En effet, lorsque le mandataire prendra connaissance de la déclaration du débiteur, il n’aura pas les moyens de vérifier l’existence d’un privilège ou d’une sûreté, ou si la créance est assortie de la continuation du cours des intérêts.
Dans ces conditions, le mandataire judiciaire prendra en compte la déclaration du seul montant de la créance faite par le débiteur pour le compte du créancier.
L’omission d’une sûreté, par le débiteur, ne pourra faire l’objet d’une rectification par le créancier que par le dépôt d’une déclaration rectificative. Dans ce cas, si la sûreté est publiée, le délai de déclaration ne courra contre lui qu’à compter de l’avertissement qu’il a l’obligation de recevoir.
Concernant la déclaration faite par le débiteur pour le compte du créancier, la Cour de cassation statue pour la première fois sur cette disposition, ce qui lui permet de préciser la mise en œuvre de cette présomption (Cour de cassation, chambre commerciale du 05/09/2018,n° 17- 18.516).
La chambre commerciale clarifie le contenu de l’information et les conditions dans lesquelles elle est portée à la connaissance du mandataire judiciaire.
Dans cette affaire, le débiteur est mis en redressement judiciaire et le jugement d’ouverture est publié au BODACC. Le créancier ayant déclaré sa créance au-delà de délai des 2 mois, dépose une requête en relevé de forclusion, laquelle, en première instance et en appel.
Il invoque dans son pourvoi l’article L. 622-24 du code de commerce.
La liste des créances remise, au mandataire judiciaire par le débiteur mentionnait l’identité du créancier, mais sans indiquer aucun montant de créance. Pour le créancier, en jugeant qu’au regard de la liste des créanciers remise par le débiteur au mandataire judiciaire, aucune créance n’avait été déclarée pour son compte, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale. En effet, la créance était citée dans le jugement d’ouverture d’où le grief fait aux juges de ne pas avoir constaté qu’elle avait été au moins partiellement portée à la connaissance du mandataire judiciaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Selon l’article L. 622-24, alinéa 3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du même code fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire.
En ayant constaté que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l’identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance et, dès lors qu’il n’était pas allégué que le débiteur avait fourni d’autres informations au mandataire judiciaire, ce qui ne pouvait se déduire des mentions du jugement d’ouverture de la procédure, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter l’existence d’une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier. … limitée au contenu de l’information fournie au mandataire
La déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier doit comporter certains éléments, à savoir, notamment, le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indications des sommes à échoir et la date de leurs échéances, nature du privilège ou de la sûreté, etc… Il est logique qu’en l’absence de mentions essentielles comme le montant de la créance, la Cour de cassation ait considéré que la déclaration du débiteur effectuée pour le compte du créancier n’existait pas.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 08/02/2003 (n° 21-19330) a confirmé, que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur, qui comporte le nom du créancier et le montant de la créance, vaut déclaration de créance faite pour le compte du créancier. Il en résulte que la présomption de déclaration par le débiteur n’est pas subordonnée à la présence sur la liste des créanciers de l’ensemble des éléments visés aux articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce, la présomption jouant alors dans la limite des éléments portéss à la connaissance du mandataire judiciaire, à défaut de déclaration de créances effectuée par le créancier.
1.1.4 – Contestation par le créancier du montant de la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire
Le 3ième alinéa de l’article L. 622-24, précise que la créance portée, par le débiteur, à la connaissance du mandataire, n’est prise en compte que dans l’hypothèse où le créancier n’effectue pas lui-même sa déclaration de créance, dans le délai des 2 mois.
Ainsi, à la lecture de l’avertissement du mandataire judiciaire qui l’informe du montant déclaré par le débiteur, le créancier, en cas de désaccord, pourra effectuer lui-même sa déclaration de créance, qui aura pour effet d’enlever toute valeur à la mention portée par le débiteur.
A défaut de déclaration faite par le créancier dans le délai de 2 mois, c’est la déclaration faite par le débiteur qui sera mentionnée sur l’état des créances.
Le juge-commissaire, peut-il relever de la forclusion, lorsque le créancier aura effectué sa déclaration de créance au-delà, en dehors du délai de 2 mois, pour remplacer la déclaration faite par le débiteur ?
Le créancier ayant été d’une part avisé par le mandataire judiciaire et d’autre part porté sur la liste établie par le débiteur, il semble difficile qu’il remplisse les conditions imposées par le premier alinéa de l’article L. 622-26.
Comme le précise l’article R. 622-21, le mandataire judiciaire ne prendra en compte que la mention que le débiteur aura portée sur la liste prévue par l’article L. 622-6, qu’il doit remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture.
1.1.5 – Contestation par le débiteur de la créance qu’il a lui-même déclarée
Cour de cassation, chambre commerciale du 23/05/2024, n° 23-12134 :
» Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité.
Ayant retenu que la liste des créanciers remise par la société Du Noireau au mandataire judiciaire mentionnant notamment une créance à échoir de la société ITM alimentaire Ouest, constituait seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, c’est à bon droit que l’arrêt en déduit qu’elle ne s’analyse pas en une reconnaissance de dette et qu’elle ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance « .
La Cour de cassation précise, sans ambiguïté, que la déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier, ne vaut pas » reconnaissance « de dette.
Cette position de la Cour de cassation semble résulter le l’article L. 622-6 du Code de commerce qui » impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire une liste qui comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie « , rend donc obligatoire pour le débiteur l’information sur toute les créances, serait-elles incertaines dans leur montant (Cour de cassation, chambre commerciale du 02/02/2022, n° 20-19157).
Dans ces conditions, le débiteur étant dans l’obligation de déclarer même les créances litigieuses, il est donc logique qu’il puisse les contester ultérieurement.
Dans un arrêt du 03/07/2024 (n° 23-15715), la Cour de cassation confirme que la liste que le débiteur doit remettre au mandataire judiciaire, doit également comporter, les créances qu’il conteste.
Dans un nouvel arrêt du 11/12/2024 (n° 23-13300) la Cour de cassation que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par le créancier, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.
1.2 – Déclaration de créance effectuée par une personne ne disposant pas de pouvoir
1.2.1 – Ratification par le créancier
L’article L. 622-24 alinéa 2 dispose que :
« Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ».
Il en résulte donc, qu’une personne sans pouvoir, peut effectuer une déclaration de créances pour le compte du créancier, et que celle-ci sera donc recevable si le créancier ratifie ladite déclaration, jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, y compris devant la Cour d’appel (ratification = manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne approuve un acte accompli par elle par une personne sans pouvoir).
Il est bien entendu obligatoire, que cette déclaration de créance faite sans pouvoir, s’effectue dans les délais légaux de la déclaration de créance.
Il est à noter que cette obligation de ratification n’existe pas en ce qui concerne la déclaration faite par le débiteur pour le compte du créancier.
Ainsi, si une contestation est émise sur le fait que la créance a été déclarée sans pouvoir, il suffira au créancier de ratifier, et cela jusque devant la Cour d’appel.
Il est donc probable qu’il n’existera plus de décision d’irrecevabilité de déclaration de créances, pour défaut de pouvoir.
1.2.2 – Caractère implicite de la ratification
Aucune forme particulière n’étant prévue pour cette ratification, celle-ci peut donc être implicite. Ainsi, le débiteur, qui dans ses conclusions, au jour de l’audience, a demandé l’admission de sa créance, a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom (Cour de cassation, chambre commerciale du 29/09/2021, n° 20-12291– du 17/11/2021, n° 20-16660 et 20-17166)
1.3 – Déclaration effectuée par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
1.3.1 – Déclaration faite par le créancier
La déclaration de créance, d’une personne morale, doit émaner des organes habilités par la loi pour la représenter (même si la désignation n’a pas été publiée – Cour de cassation chambre commerciale du 12/07/2004 n° 03-14557) c’est-à-dire pour une société, suivant sa forme, à savoir :
- par le président du conseil d’administration (articles L. 225-51-1 et L. 225-56 I du code de commerce, sauf clause contraire des statuts),
- par le président du directoire,
- par le directeur général unique, le directeur général spécialement habilité
- par le gérant,
- par le liquidateur amiable d’une société, même si sa nomination n’a pas été publiée.
S’agissant de la SAS, seul le président a le pouvoir légal d’agir en justice et donc de déclarer une créance. Le directeur général ou le directeur général délégué ne disposent de ce pouvoir que dans l’hypothèse de dispositions statutaires l’indiquant (article L. 227-6 du code de commerce – Cour de cassation chambre commerciale du 14/12/2010 n° 09-71712).
Si la qualité d’administrateur d’une société anonyme ne confère pas le pouvoir de représenter la société en justice (Cour de cassation chambre commerciale du 3/10/2006 n° 05-13244), le conseil d’administration a le pouvoir de nommer un préposé de la société pour déclarer les créances avec ou sans faculté de délégation (Cour de cassation chambre commerciale du 28/09/2004 n° 03-12023).
Il est à noter que le représentant d’une personne morale n’est tenu par aucun texte de préciser sur la déclaration de créance son identité et sa qualité (Cour de cassation chambre commerciale du 13/11/2002 n° 99-21871).
Le fait que le débiteur ne conteste pas devoir la somme déclarée n’autorise pas le juge-commissaire à admettre la créance au passif, dès lors qu’une contestation porte sur le pouvoir de déclarer la créance (Cour de cassation chambre commerciale du 30/10/2010 n° 10-10415).
Nous avons maintenu ce paragraphe, malgré les modifications apportées par l’ordonnance du 12 mars 2014 et le décret du 30 juin 2014, qui autorise une personne habilitée à représenter une personne morale à ratifier une déclaration faite en son nom, par une personne ne disposant pas de pouvoir.
Examinons quelques que cas particuliers.
1.3.1.1 – Les collectivités territoriales
S’il s’agit d’une collectivité territoriale, il résulte de l’article L. 2343-1, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, que seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut les déclarer au passif du débiteur (Cour de cassation chambre commerciale du 23/10/2007 n° 06-19069).
1.3.1.2 – Trésor public
Pour les impôts, le comptable public territorialement compétent est habilité à produire la déclaration de créance au nom du Trésor public.
L’article 410 de l’annexe II du code général des impôts prévoit que chaque fonctionnaire des impôts peut déléguer sa signature aux agents placés sous sa responsabilité, qui dispose donc du pouvoir d’effectuer la déclaration de créance (il s’agit ici d’une délégation de signature et non de pouvoir – Cour de cassation chambre commerciale du 25/06/2002 n° 00-20162).
1.3.1.3 – URSSAF
Le directeur général de l’URSSAF tire des articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale le pouvoir de décider des actions en justice à engager à l’égard des cotisants et de déléguer l’exercice de ses actions à un agent, sans qu’il soit besoin d’une autorisation du conseil d’administration de cet organisme.
1.3.1.4 – Association
Le président doit être muni d’un pouvoir spécial, sauf indication spécifique dans les statuts (Cour de cassation chambre civile 1 du 19/11/2002 n° 00-18946).
S’il ne dispose pas de ce pouvoir, il ne peut donc le déléguer à un autre membre de l’association.
1.3.1.5 – Syndicat de copropriétaire
La 3ième chambre civile de la Cour de cassation, reconnaît au syndic de copropriété le pouvoir de déclarer une créance du syndicat (cour de cassation chambre commerciale du 19/05/2004 n° 02-14805).
1.3.2 – Déclaration effectuée par un préposé ou un mandataire.
L’article L. 622-24 dispose que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
Si elle n’émane pas de ses représentants légaux, la déclaration peut être effectuée par tout préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’accomplir un tel acte.
S’agissant d’un mandataire, qui déclare la créance d’un tiers, il doit si, il n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial donné par écrit (mandat ad litem des articles 416 et 853 du code de procédure civile).
Un pool bancaire n’ayant pas la personnalité morale, la Cour de cassation exige du « chef de file » du pool qu’il dispose d’un mandat écrit donné par chacune des autres banques (Cour de cassation assemblée plénière du 26/01/2001 n° 99-15153).
En dehors de ces quelques remarques, il ne nous est pas apparu utile de détailler les différentes contestations concernant la délégation de pouvoir ou le pouvoir spécial, prenant en compte le fait que le créancier pourra toujours ratifier une déclaration de créances qui n’aurait pas été faite par une personne disposant d’un pouvoir.
2. – Destinataire de la déclaration de créance
Les créances doivent être déclarées selon le cas au mandataire ou au liquidateur qui ont seuls la qualité pour recevoir les déclarations.
A noter que la désignation par le tribunal de deux mandataires en précisant la mission plus particulièrement confiée à chacun d’eux, l’un d’eux pouvant être chargé plus spécialement de la vérification des créances est sans incidence sur la fonction dont est légalement investi cet organe de la procédure. Il suffit pour être régulière que la déclaration de créance litigieuse ait été adressée dans le délai légal à l’un des mandataires (Cour de cassation chambre commerciale du 24/04/2007, n° 05-20280).
L’envoi de la déclaration de créance au cabinet secondaire du mandataire de justice est valable, même si l’avis d’avoir à déclarer la créance ne fait apparaître que l’adresse du cabinet principal du mandataire judiciaire.
En revanche, une créance déclarée auprès d’une autorité incompétente n’interrompt pas le délai de déclaration.
TROISIEME PARTIE : CONTENU DE LA DECLARATION DE CREANCE
1. – Contenu de la déclaration de créance
1.1 – Règles générales.
Il convient tout d’abord de préciser que dans la mesure où les articles L. 622-24 et R. 622-23 du Code de commerce ne prévoient pas la forme précise que doit revêtir l’écrit par lequel le créancier fait sa déclaration de créance, il revient au juge-commissaire d’apprécier souverainement si l’écrit envoyé au mandataire judiciaire exprime de manière non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance (Cour de cassation chambre commerciale du 15/02/2011 n° 10-12149).
La déclaration de créance doit être accompagnée des pièces justificatives (articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce).
Toutefois, la méconnaissance de ses dispositions n’est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration de créance dès lors que le mandataire peut à tout moment demander la production des documents qui n’auraient pas été joints (Cour de cassation chambre commerciale du. 17/12/2003 n° 01-10692).
Il n’en demeure pas moins que la charge de la preuve du contenu de la déclaration incombe au créancier.
1.2 – Montant de la déclaration de créances.
Le montant de la créance revendiquée doit être indiqué précisément en principal, intérêts et accessoires article L. 622-25 alinéa 1 et R. 622-23).
Il doit être rappelé que la créance à admettre doit être celle existant au jour de l’ouverture de la procédure collective, indépendamment des événements qui ont pu l’affecter postérieurement. (Cour de cassation chambre commerciale du 11/10/2011 n° 10-17523).
Il est possible d’effectuer des déclarations de créances complémentaires, mais exclusivement dans le délai de la déclaration de créance, même en ce qui concerne les déclarations de créances effectuées par estimation.
Il paraît difficile d’admettre qu’une déclaration complémentaire pourrait faire l’objet d’un relevé de forclusion.
1.2.1 – Interdiction de principe des déclarations de créances à titre provisionnel.
Seuls les organismes sociaux ou fiscaux peuvent déclarer leurs créances à titre provisionnel ou indicatif, les autres créanciers ne bénéficient pas de cette possibilité (article L. 622-24).
Si le montant de la créance ne peut être indiqué, faute d’être définitivement fixé à la date de la déclaration, le créancier doit procéder à son estimation, son évaluation sans pouvoir demander l’admission d’une créance à titre provisionnel.
Mais il ne faut pas nécessairement s’arrêter aux termes employés, le juge dispose du pouvoir souverain d’interpréter l’intention du créancier, dans sa déclaration.
Ainsi, il a été jugé qu’il importe peu qu’une déclaration ait été faite « à titre provisionnel » dès lors qu’il est constant que ce terme aurait dû être remplacé par l’expression « à titre prévisionnel » ou par toute autre expression signifiant qu’il s’agissait d’une évaluation et qu’il en ressortait ainsi que cette déclaration de créance révélait la volonté non équivoque de la part du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée, sauf à user de la faculté de confirmer ou de réduire l’évaluation jusqu’à la décision d’admission (Cour de cassation chambre commerciale du. 26/09/2006 n° 05-16942).
Dans le même sens, les arrêts de la chambre commerciale du 7/03/2006 n° 04-19078 et du 14 mai 2008 n° 07-12891, pour une caisse de retraite complémentaire, créancier de droit commun.
Voir également l’arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 6/07/2010 n° 09-68474 pour une déclaration de créance “faite à titre provisoire, sauf à parfaire”.
1.2.2 – La particularité des déclarations de créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité : déclaration à titre provisionnel
1.2.2.1 – Institutions et organismes habilités à effectuer des déclarations de créances à titre provisionnel
Les organismes de prévoyance et de sécurité sociale visés l’article L. 622-24 du Code de commerce sont ceux qui, comme le Trésor Public sont habilités à se délivrer des titres exécutoires (ASSEDIC, URSSAF, MSA).
Ce n’est pas le cas de la Caisse des congés payés du bâtiment (Cour de cassation, chambre commerciale du 12/04/2005, n° 02-13053).
La déclaration à titre provisionnel ne devrait concerner que les créances non couvertes par un titre exécutoire (le titre exécutoire pour les impôts est le rôle, pour les organismes sociaux il est constitué par la contrainte).
En conséquence, une créance couverte par un titre au jour de la déclaration, sera admise à titre définitif, même si le titre est contesté (Cour de cassation chambre commerciale du 10/03/2004 n° 01-01265).
Les créances antérieures de ces institutions ou organismes, non encore établies ou non couvertes par un titre exécutoire, doivent faire l’objet d’une déclaration de créance dans les délais légaux, à titre provisionnel.
Cette déclaration à titre provisionnel constitue le montant maximum, auquel la créance pourra être admise définitivement.
1.2.2.2 – Modalités de conversion d’une déclaration de créance provisoire en déclaration de créance définitive (L. 622-24 alinéa 4 et R. 624-6).
Le trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, habilités à se délivrer des titres exécutoires, doivent solliciter obligatoirement leur admission définitive dans le délai de 12 mois de la parution de l’ouverture de la procédure au BODACC ‘sauf procédures ou contrôle en cours).
Ce délai est opposable au créancier par le seul effet de la publication du jugement d’ouverture, même si le délai fixé par le tribunal pour l’établissement de la liste des créances déclarées ne figure pas parmi les mentions de l’avis publié au BODACC.
L’admission définitive après établissement définitif de la créance ne pourra intervenir pour une somme supérieure au montant déclaré à titre provisionnel, même si la déclaration a été faite sur la base d’une évaluation (Cour de cassation chambre commerciale du 03/11/2010).
En revanche, ces créanciers peuvent procéder à des déclarations rectificatives de la déclaration définitive de leurs créances, à condition, que celles-ci soient faites dans les délais et que le montant soit au plus égal à la déclaration provisionnelle (Cour de cassation chambre commerciale du 05/10/2010 n° 09-16558).
Si le titre exécutoire a été émis dans le délai d’établissement définitif des créances et a été régulièrement dénoncé dans ce délai au représentant des créanciers, il suffit au créancier de demander son admission définitive par requête adressée au juge-commissaire pour qu’il ait ainsi satisfait à toutes les exigences légales pour obtenir l’admission de ses créances à titre définitif sans qu’il puisse être exigé qu’il effectue en outre auprès du mandataire judiciaire une déclaration de créances à titre définitif (Cour de cassation chambre commerciale du 13/11/2007, n° 06-17083).
En revanche, faute d’émission d’un titre exécutoire dans ce délai, ce dont il appartient au créancier qui sollicite son admission à titre définitif de justifier, la créance ne peut être admise à titre définitif, elle reste admise à titre provisionnel et elle est donc inopposable au débiteur pendant l’exécution de son plan.
1.2.3 – La déclaration des intérêts.
1.2.3.1 – Intérêts échus et impayés avant jugement d’ouverture
Le créancier doit déclarer les intérêts échus et impayés avant jugement d’ouverture. Le créancier n’a pas ici l’obligation d’indiquer le mode de calcul de ces intérêts échus.
1.2.3.2 – Intérêts à échoir dont le cours n’est pas arrêté
Les intérêts à échoir ne peuvent être déclarés que pour les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à 1 an (article L. 622-28 du Code de commerce).
Dès lors que la convention de compte courant ne précise ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée, ni les modalités de son remboursement, le compte courant ne saurait constituer un prêt à plus d’un an, les modalités de remboursement accordées lors de la cession des titres ne lui conférant pas cette qualité (Cour de cassation, chambre commerciale du 23/04/2013, n° 12-14283).
La déclaration de créance doit indiquer, à défaut d’un montant précis, « les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté » (Article R. 622-23 du Code de commerce) – Cour de cassation, chambre commerciale du 22/03/2017, n° 15-19481).
De même, la mention dans la déclaration de créance, d’intérêts à échoir “pour mémoire”, sans indication de leur taux ni de leur mode de calcul, et sans renvoi aux documents joints à la déclaration, ne vaut pas déclaration régulière (Cour de cassation chambre commerciale du 05/04/2016, n° 14-20169).
La seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de ladite créance et de l’indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, soit en l’absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même, soit par un renvoi express de dans la déclaration à un document joint indiquant ces modalités, peut valoir déclaration des intérêts dont le cours n’était pas arrêté (Cour de cassation, chambre commerciale du 23/11/2022, n° 21-14116)
1.2.4 – La déclaration de l’indemnité d’exigibilité anticipée
Les contrats de prêt bancaire contiennent généralement une clause d’indemnité d’exigibilité anticipée, qui a vocation à s’appliquer en cas de déchéance du terme.
Cette créance a la nature d’une créance antérieure. Le fait générateur étant constitué par le prêt, elle doit en conséquence être déclarée au passif (Cour de cassation, chambre commerciale du 27/06/2006, n° 05-12306).
1.2.5 – Indemnité de recouvrement
Arrêt récent de la Cour de cassation à méditer.
Cour de cassation, chambre commerciale du 22/02/2017, n° 15-15942
« Mais attendu que, saisie d’une demande de fixation d’une créance correspondant au capital prêté dans son intégralité et à échoir, ce dont il résultait que le prêt n’était pas exigible à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la débitrice et que cette dernière n’était pas défaillante dans l’exécution de ses obligations, la cour d’appel, après avoir relevé que, selon la clause litigieuse, l’indemnité de recouvrement de 5 % était due si la banque se trouvait dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, et également si la banque était tenue de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur, en a exactement déduit qu’en l’espèce, une telle clause aggravait les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde ;
Que par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ».
1.2.6 – L’indemnité de résiliation d’un contrat à exécutions successives
Si le contrat était résilié au jour du jugement d’ouverture, aucune difficulté ne peut se présenter. L’indemnité de résiliation a nécessairement la nature d’une créance antérieure, puisque son fait générateur, à savoir la résiliation, est fixé avant jugement d’ouverture. Cette indemnité doit faire l’objet d’une déclaration.
S’il s’agit d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, la résiliation peut résulter :
- soit de la décision de l’organe compétent de ne pas continuer le contrat,
- soit l’organe compétent ayant opté pour la continuation du contrat, mais le cocontractant ne respectant pas ses obligations.
Dans les deux cas la résiliation peut donner lieu à une indemnité de résiliation. ou des dommages et intérêts dont le montant doit faire l’objet d’une déclaration de créance au passif, s’agissant de créances antérieures (article L. 622-17-III 2° du Code de commerce).
En application de l’article R. 622-21 du Code de commerce, ces créanciers bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation.
Rappelons que :
- la créance résultant du non-paiement des prestations exécutées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, constitue une créance postérieure,
- l’indemnité de résiliation, si elle peut être qualifiée de clause pénale, peut être contestée et faire l’objet d’une réduction par le juge commission, par décision motivée.
1.2.7 – La déclaration des sûretés
L’indication de la présence d’une sûreté assortissant la créance est obligatoire.
A défaut de mention, la garantie est éteinte.
1.2.8 – Déclaration des créances non exigibles
Les créances non exigibles au jour du jugement d’ouverture doivent faire l’objet d’une déclaration de créance.
Rappelons que le jugement d’ouverture de la sauvegarde ou du redressement judiciaire n’emporte pas déchéance du terme, laquelle ne résultera que de la liquidation judiciaire, sauf poursuite provisoire de l’activité.
1.2.8.1 – Déclaration des créances en présence d’un contrat à exécution instantanée
En matière de vente, dès lors que la livraison de la chose est antérieure au jugement d’ouverture, la créance du prix doit être, pour la totalité, déclarée au passif, même si l’obligation de payer était prévue postérieurement au jugement d’ouverture.
En matière de prêt, il convient de déclarer au passif, distinctement les sommes échues et les sommes à échoir, en précisant pour celles-ci la date d’échéance (article L. 622-25 du Code de commerce).
L’erreur commise dans la déclaration de créance, qui consiste à déclarer comme échues des créances qui sont à échoir, n’est pas sanctionnée par l’extinction de la créance (Cour de cassation, chambre commerciale du 28/09/2014, n° 03-12023).
Symétriquement, la déclaration de créances de sommes à échoir, qui étaient échues au jour du jugement d’ouverture, restera sans conséquence, dès lors que le créancier a manifesté sa volonté non équivoque de réclamer les créances à échoir (Cour de cassation, chambre commerciale du 09/01/2001, n° 97-22048).
1.2.8.2 – Déclaration des créances en présence de contrat à exécution successive
Il faut ici supposer que les obligations du contrat naissent au fur et à mesure du déroulement du contrat, un crédit-bail par exemple.
L’article L. 622-24 du Code de commerce indique que le créancier doit déclarer les créances antérieures. Il ne convient donc pas de déclarer les créances postérieures.
Ne pas faire de confusion avec l’article L. 622-25 du Code, qui fait mention des sommes à échoir, mais uniquement lorsqu’il s’agit de créances antérieures et non de créances postérieures.
1.2.9 – Déclaration du compte bancaire non clôturé
La banque doit établir un arrêté provisoire au jour de l’ouverture de la procédure collective. Si le montant est débiteur, il convient de le déclarer à la procédure collective.
Cet arrêté provisoire ne vaut pas clôture du compte et en conséquence cette somme ne peut faire l’objet d’une demande en paiement à l’encontre de la caution (sauf convention contraire entre les parties).
2. – Le sort des créances non déclarées et créances rejetées.
2.1 – Les créances non déclarées
Depuis la loi de sauvegarde des entreprises, les créances non déclarées ne sont plus éteintes. Elles sont inopposables à la procédure collective.
Si la créance non déclarée est inopposable à la procédure, la créance n’est pas éteinte.
L’ordonnance du 18 décembre 2008 dispose, en ce qui concerne la procédure de sauvegarde (article L. 622-26 du Code de commerce) que la créance non déclarée :
- est inopposable au débiteur :
- pendant l’exécution du plan,
- après l’exécution du plan, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
- qu’elles sont inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou cédé un bien en garantie, pendant l’exécution du plan.
En application de l’article L. 631-14 alinéa 7, les dispositions, concernant la caution, ne sont pas applicables en cas de redressement judiciaire.
Ainsi :
- il résulte des dispositions de l’article L. 622-26 du Code de commerce que la défaillance du créancier, ayant pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement. (Cour de cassation chambre commerciale du 12/07/2011 n° 09-71113)
- pour que la caution puisse être déchargée de son obligation, en application de l’article 2314 du code civil, du fait que la subrogation dans un droit préférentiel ne peut plus s’opérer, par le fait du créancier (défaut de déclaration de créance), encore faut-il qu’elle démontre qu’elle aurait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admis dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation (même arrêt de la Cour de cassation que ci-dessus). Cette démonstration semble facile à démontrer dans l’hypothèse d’un redressement judiciaire, paraît plus difficile en liquidation judiciaire.
Les créances, qui n’ont pas été déclarées au passif d’une première procédure, n’étant plus éteinte, le créancier peut déclarer sa créance au passif d’une seconde procédure ouverte suite à la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
2.2 – Les créances rejetées
Cour de cassation, chambre commerciale du 30/01/2019, n° 17-31060 :
Mais attendu qu’après avoir retenu à bon droit que l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement et que si l’article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, le texte ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure, l’arrêt relève que les deux créances à nouveau déclarées par la banque sont justifiées et ne sont pas spécialement critiquées par le débiteur ; que par ce seul motif, la cour d’appel, qui n’a pas relevé d’office un moyen, qui était dans le débat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
En l’espèce, une banque déclare au passif d’un débiteur deux créances pour environ respectivement 354 000 et 378 000 euros, mais n’est admise au passif que pour 145 et 144 euros. Un plan de redressement est adopté et ces deux créances sont réglées immédiatement en application de l’article L. 626-20, II du Code de commerce pour les créances inférieures à 500 euros. Ce plan est ensuite résolu et la banque déclare à nouveau ses créances rejetées à la première procédure, ce à quoi, bien évidemment, le débiteur s’oppose.
La question posée est donc :
- option 1, est-ce que l’extinction des deux créances au passif de la première procédure collective est-elle définitive et s’impose-t-elle, dans le cadre de la seconde procédure collective ?
- ou option 2, au contraire, faut-il admettre l’indépendance des deux procédures collectives et l’absence d’autorité de la chose jugée de la décision de rejet de la créance déclarée au passif de la première procédure collective dans le cadre de la seconde ?
La Cour de cassation a choisi l’option n° 2.
Il faut retenir de cette décision que le rejet de la créance au passif de la première procédure collective ne vaut que pour cette procédure et n’a pas d’autorité de chose jugée dans le cadre de la seconde procédure. Le créancier, dont la créance a été rejetée au passif d’une première procédure, peut donc valablement déclarer sa créance au passif de la seconde, pour être admis dans des conditions différentes de celles de la première procédure. En d’autres termes, la décision de rejet n’emporte pas extinction définitive de la créance.
Bien évidemment cette deuxième déclaration pourra à nouveau être rejetée si le motif de rejet reste identique. Ainsi, si le premier motif de rejet concerne une absence de pouvoir du signataire de la déclaration de créance, si la deuxième déclaration est régulière, elle devrait être admise dans la seconde procédure.
Ce pose alors le problème du cautionnement de ces créances et en particulier si une décision a constaté la nullité du cautionnement, au regard du rejet de la déclaration de créance, l’admission de la seconde déclaration de créance ne devrait pas faire bénéficier le créancier du cautionnement.