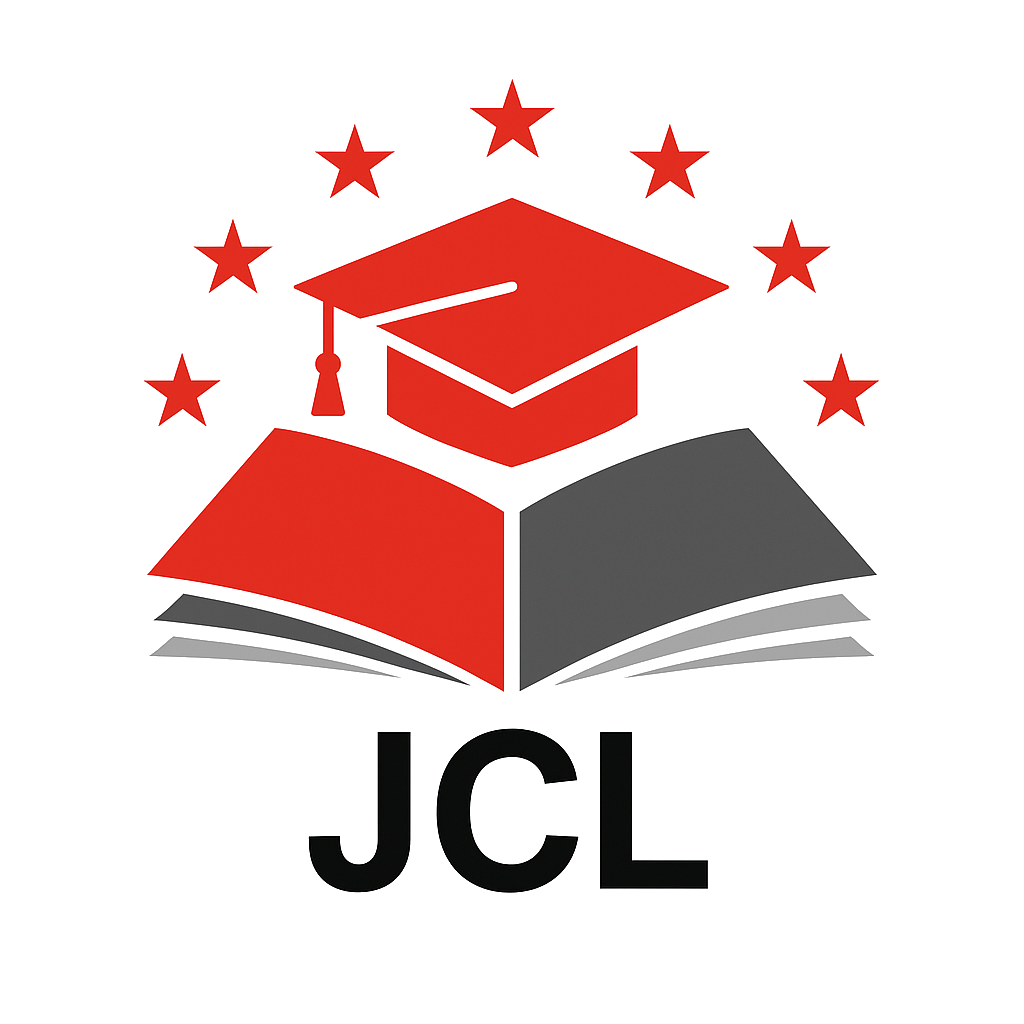Cautionnement : généralité, formation,
étendue et sous-cautionnement
(Caution personne physique et créancier professionnel)
- 0. – Objet de la présente étude
- 1. – Présentation générale du cautionnement
- 2. – Le consentement des parties
- 3. – Le cautionnement acte civil ou commercial ?
- 4. – Etendue du cautionnement
- 5. – Durée du cautionnement
- 6. – Distinction entre le cautionnement simple et le cautionnement solidaire
- 8. – Le cautionnement au regard de la situation patrimoniale de la caution
- Contrat unilatéral : seul la caution s’oblige, le débiteur n’est pas partie au contrat, même si c’est souvent lui qui sollicite la garantie.
- Contrat accessoire : le cautionnement suit la dette principale, il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et s’éteint avec la dette.
- Exceptions opposables :
▪️avant 2022 : seules les exceptions inhérentes à la dette (nullité, prescription, paiement, etc.).
▪️depuis 2022 (art. 2298 C. civ.) : toutes les exceptions, y compris personnelles, sauf celles liées à la défaillance du débiteur (délais de grâce, procédure collective…). - Etendue de l’engagement : la caution peut garantir dettes présentes ou futures, déterminées ou déterminables (art. 2292 C. civ.).
- Montant garanti :
▪️avant 2022 : obligation de plafond seulement en faveur des créanciers professionnels (art. L. 331-1 C. consom.).
▪️depuis 2022 : tout cautionnement par une personne physique doit mentionner un plafond, à peine de nullité (art. 2297 C. civ.). - Durée :
▪️avant 2022 : durée déterminée obligatoire (mention manuscrite).
▪️depuis 2022 :✓ si obligation à terme → même durée ;
✓ si obligation sans terme → cautionnement à durée indéterminée, résiliable par la caution (art. 2315 C. civ.). - Cautionnement simple : la caution bénéficie du bénéfice de discussion et de division (art. 2305 et 2306 C. civ.).
- Cautionnement solidaire : la caution ne peut bénéficier du bénéfice de discussion et de division et la solidarité doit être expressément stipulée (art. 2297, al. 2 C. civ.) → le créancier peut réclamer le tout à une seule caution, sans discussion ni division.
- Sous-cautionnement : admis et désormais codifié (art. 2291-1 C. civ.) → la sous-caution s’engage envers la caution, pas envers le créancier.
- Sous-caution et disproportion : comme toute caution personne physique, la sous-caution peut invoquer la disproportion manifeste de son engagement (art. 2300 C. civ.).
- Régime matrimonial :
▪️art. 1415 C. civ. : un époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, sauf consentement exprès du conjoint.
▪️si consentement : les biens communs sont engagés, mais non les biens propres du conjoint.
0. – Objet de la présente étude
Comme l’indique le titre, cette étude traite exclusivement du cautionnement donné par une personne physique au profit d’un créancier professionnel — type de litige qui constitue la quasi-totalité des affaires soumises aux tribunaux de commerce.
Sont exclus du périmètre :
le cautionnement consenti par une personne morale ;
le cautionnement d’une personne physique au profit d’un créancier non professionnel (sauf exceptions ponctuelles) ;
les cautionnements signés avant le 1er septembre 2003.
En revanche, sont intégrées les modifications issues de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui a profondément réformé le droit du cautionnement.
Ces dispositions s’appliquent aux actes conclus à compter du 1er janvier 2022.
1. – Présentation générale du cautionnement
Article 2288 du Code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021) :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part, et même à son insu. »
Le cautionnement est donc un contrat présentant deux caractéristiques majeures :
il est unilatéral, car seule la caution s’engage vis-à-vis du créancier ;
il est accessoire d’un contrat principal, puisqu’il a pour objet de garantir l’exécution de l’obligation du débiteur.
1.1 – Le cautionnement : un contrat unilatéral conférant garantie personnelle
Le cautionnement est un contrat conclu entre la caution et le créancier.
Le débiteur principal n’est pas partie à ce contrat, même si c’est souvent lui qui sollicite l’engagement de la caution.
C’est un contrat unilatéral, car seule la caution assume une obligation juridique directe. Les obligations secondaires mises à la charge du créancier (notamment les devoirs d’information) ne remettent pas en cause ce caractère.
Il s’agit en outre d’une garantie personnelle : le créancier n’obtient pas un droit réel sur un bien de la caution (comme avec une hypothèque), mais dispose d’un gage général sur l’ensemble de son patrimoine.
1.2 – Le cautionnement : un contrat accessoire
Le cautionnement est l’accessoire de l’obligation principale : il a pour finalité de garantir le paiement de la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Ce caractère accessoire emporte deux conséquences essentielles :
le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ;
la caution peut opposer au créancier certaines exceptions appartenant au débiteur.
1.2.1 – Limitation du cautionnement à la dette principale
L’article 2296 du Code civil précise :
« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. »
Ainsi, l’obligation de la caution est strictement délimitée : elle ne garantit que la défaillance du débiteur, et uniquement dans la limite prévue au contrat.
1.2.2 – Exceptions opposables au créancier
La caution est en droit d’opposer au créancier certains moyens de défense appartenant au débiteur, afin de se libérer ou de limiter son engagement.
Par « exception », on entend tout moyen de droit qui tend à faire échec à l’action du créancier (nullité, prescription, extinction de la créance, inexécution…).
On distingue :
les exceptions inhérentes à la dette : elles concernent l’existence, la validité, l’étendue ou les modalités de la créance (exemples : prescription, nullité, compensation, caducité).
les exceptions personnelles au débiteur : elles touchent à la personne du débiteur (exemples : incapacité, délais de grâce, suspension des poursuites en procédure collective).
1.2.2.1 – La situation avant le 01/01/2022 : seules les exceptions inhérentes à la dette
Avant la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021, la caution ne pouvait invoquer que les exceptions inhérentes à la dette.
Elle ne pouvait pas se prévaloir des exceptions purement personnelles au débiteur, même si elles avaient pour effet d’éteindre l’action du créancier à l’encontre de celui-ci.
Jurisprudence
Cour de cassation, chambre mixte du 8 juin 2007, n° 03-15602
La caution ne peut invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal : il s’agit d’une exception personnelle, destinée à protéger ce dernier.Cour de cassation, chambre commerciale du 13 octobre 2015, n° 14-19734
La fin de non-recevoir tirée du non-respect d’une clause de conciliation préalable ne constitue pas une exception inhérente à la dette. La caution ne peut donc pas l’opposer.Cour de cassation, chambre commerciale du 11 décembre 2019, n° 18-16147
La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (protectrice du consommateur) ne peut être invoquée par la caution : elle constitue une exception purement personnelle au débiteur consommateur.
1.2.2.2 – Situation à compter du 01/01/2022 : exceptions inhérentes à la dette et personnelles
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, l’article 2298 du Code civil dispose que :
« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
Principe nouveau
La caution peut désormais invoquer toutes les exceptions du débiteur, qu’elles soient :
inhérentes à la dette (nullité, prescription, paiement, compensation, caducité…),
ou personnelles au débiteur (dol, incapacité, statut de consommateur…).
C’est un élargissement considérable par rapport à l’ancien droit.
Deux limites posées par la loi
Incapacité du débiteur → la caution ne peut pas se prévaloir de la protection spécifique accordée à un incapable (mineur ou majeur protégé).
Mesures légales ou judiciaires liées à la défaillance → la caution ne peut pas invoquer les délais de grâce, la suspension des poursuites en procédure collective, ou encore la sauvegarde/redressement, sauf texte spécial contraire.
1.3 – Les rapports entre les parties
Le cautionnement fait intervenir trois acteurs :
le créancier,
le débiteur principal,
la caution.
De là découlent plusieurs rapports juridiques distincts.
1.3.1 – Rapport principal entre le créancier et le débiteur principal.
Le cautionnement suppose toujours une obligation principale valable.
Si l’obligation principale est nulle, le cautionnement disparaît également (article 2293 du Code civil, ancien article 2289).
Toutefois, certaines obligations subsistent malgré la nullité du contrat, ce qui maintient le cautionnement pour ces dettes.

Prêt annulé : le cautionnement subsiste tant que les sommes prêtées n’ont pas été remboursées (Cour de cassation, chambre commerciale du 4 juin 1996, n° 93-18612).
Contrat de franchise annulé : les dettes antérieures à l’annulation demeurent garanties (Cour de cassation, chambre commerciale du 12 novembre 2008, n° 07-17746).
Enfin, l’article 2292 Code civil rappelle que :
« Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. »
1.3.2 –Rapport accessoire entre le créancier et la caution.
Bien que lié à l’obligation principale, le cautionnement constitue un contrat autonome conclu entre le créancier et la caution.
Le débiteur principal est donc juridiquement tiers à ce contrat.
Le consentement de la caution est toujours volontaire (nul n’est obligé par la loi ou le juge à se porter caution).

1.3.3 – Rapport entre la caution et le débiteur principal.
Le rapport entre la caution et le débiteur principal ne prend effet qu’en cas de défaillance du débiteur.
Le cautionnement est, dans la majorité des cas, conclu sans accord exprès du débiteur.
En effet, il n’y a pas de véritable rencontre des volontés entre le débiteur et la caution.
Juridiquement, il n’existe donc pas de contrat entre ces deux parties.

Une fois le créancier payé, la caution dispose de deux recours distincts :
- recours personnel article (article 2308 du Code civil) : la caution réclame au débiteur les sommes versées, les intérêts et frais, et éventuellement des dommages et intérêts supplémentaires.
- recours subrogatoire (article 2309 du Code civil) : la caution se trouve » subrogée » dans les droits du créancier et bénéficie des mêmes garanties (hypothèques, nantissements, privilèges…).
1.3.4 – Rapport entre cautions (pluralité de cautions)
En présence de plusieurs cautions :
La caution qui a payé pour le tout peut exercer un recours personnel et subrogatoire contre ses co-cautions (article 2312 du Code civil).
Elle ne peut cependant les poursuivre que pour leur part contributive.

Trois cautions solidaires garantissent une dette de 90 000 €.
Le créancier réclame 90 000 € à une seule caution.
Cette caution, après paiement, peut réclamer 30 000 € à chacune des deux autres.
2. – Le consentement des parties
Le cautionnement, comme tout contrat, suppose un consentement libre et éclairé de la caution.
Les règles de droit commun relatives aux vices du consentement (erreur, dol, violence) s’appliquent pleinement. Pour une analyse complète, il convient de se reporter à l’étude spécifique consacrée aux vices du consentement.
Voici seulement les rappels utiles pour le juge consulaire.
👉 Erreur
La nullité du cautionnement peut être retenue si l’erreur de la caution porte sur un élément déterminant de son engagement.
Exemple : une erreur sur l’existence d’autres sûretés ou garanties déjà consenties au profit du créancier peut vicier le consentement, dès lors que cette donnée a déterminé la décision de se porter caution.
(Cour de cassation, première chambre civile, 1er juillet 1997, numéro 95-12163)
👉 Dol
La nullité est encourue si le créancier a intentionnellement dissimulé à la caution une information essentielle, telle que la situation irrémédiablement compromise du débiteur principal. Cette réticence dolosive prive la caution d’un consentement éclairé.
(Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2014, numéro 13-20766)
👉 Violence
La violence, y compris morale, n’est admise qu’à titre exceptionnel. Elle suppose la démonstration de pressions ou de contraintes de nature à priver la caution de son libre arbitre. La Cour de cassation adopte une appréciation stricte, refusant de qualifier de violence de simples démarches insistantes du créancier.
(Cour de cassation, chambre commerciale, 22 janvier 2013, numéro 11-17954)
3. – Le cautionnement acte civil ou commercial ?
Le cautionnement soulève la question de sa nature juridique. Selon qu’il est qualifié d’acte civil ou d’acte commercial, les règles applicables (juridiction compétente, preuve, prescription) peuvent varier.
👉 Jusqu’au 1er janvier 2022, la distinction reposait sur une jurisprudence fluctuante, parfois difficile à anticiper. Depuis la réforme du 15 septembre 2021, le législateur a clarifié la situation par l’introduction d’un 11° à l’article L. 110-1 du Code de commerce, rédigé ainsi :
« La loi répute actes de commerce : (…)
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »
📊 Tableau comparatif – Qualification du cautionnement
| 🔹 Éléments | Avant le 01/01/2022 | Depuis le 01/01/2022 |
|---|---|---|
| Principe | Le cautionnement était civil par nature. | Le cautionnement d’une dette commerciale est automatiquement commercial. |
| Exception | Il pouvait être commercial si la caution avait un intérêt patrimonial personnel (par exemple, le dirigeant garantissant les dettes de sa société). | Aucune distinction selon la qualité de la caution. |
| Conjoint caution | Le conjoint n’était considéré comme ayant un intérêt patrimonial que s’il se comportait comme un dirigeant de fait. | La commercialité résulte uniquement de la nature de la dette principale : le cautionnement en devient commercial. |
| Source | Jurisprudence variable et incertaine, analyse au cas par cas. | Article L. 110-1, 11° du Code de commerce. |
| Conséquence | Insécurité juridique et disparités d’appréciation. | Solution claire et uniforme : le cautionnement suit la nature de la dette garantie. |
✋ Points essentiels pour le juge consulaire
Si la dette principale est civile → le cautionnement est civil.
Si la dette principale est commerciale → le cautionnement est commercial, quelle que soit la qualité de la caution (dirigeant, conjoint, tiers).
La notion d’« intérêt patrimonial » disparaît : elle n’a plus à être démontrée.
Cette modification issue de l’article L. 110-1, 11° du Code de commerce ne s’applique qu’aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022.
Pour les cautionnements antérieurs, la jurisprudence antérieure (analyse au cas par cas, selon l’intérêt patrimonial de la caution) reste applicable.
4. – Etendue du cautionnement
Le cautionnement ne porte pas seulement sur le capital de la dette principale : il s’étend également aux intérêts, pénalités et accessoires, sauf clause contraire.
L’ordonnance du 15 septembre 2021 (applicable depuis le 1er janvier 2022) a précisé ce régime et en a élargi la portée.
4.1 – Obligations garanties : dettes présentes ou futures
Article 2292 du Code civil :
« Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. »
Dettes présentes : existantes au jour de la signature (exemple : un prêt déjà consenti).
Dettes futures : susceptibles de naître ultérieurement (exemple : solde débiteur d’un compte courant).
📌 Dans tous les cas, le contrat doit permettre d’identifier les dettes garanties.
La dette n’a pas besoin d’être chiffrée dès l’origine, mais elle doit être déterminable grâce à des critères objectifs.
4.2 – Montant garanti : principal et accessoires
Le cautionnement ne se limite pas au capital de la dette principale, sauf stipulation contraire, il s’étend aussi aux intérêts, pénalités et intérêts de retard et parfois même aux frais. Cette distinction est importante car elle détermine le montant réel que la caution peut être appelée à payer.
4.2.1 – Le principal
Avant le 1er janvier 2022 :
L’article L. 331-1 du Code de la consommation imposait une mention manuscrite précisant le montant maximal de l’engagement, en principal, intérêts et frais.
Depuis le 1er janvier 2022 :
L’article 2297 du Code civil impose toujours la fixation d’un plafond, mais il oblige la mention du plafond en chiffres et en lettres (les lettres priment en cas de discordance).
👉 Qu’il soit signé avant ou à compter du 1er janvier 2022, à défaut de plafond, le cautionnement est nul.
👉 Rappel : la mention manuscrite n’est pas exigée si le cautionnement est un acte authentique ou contresigné par avocat.
👉 Rappelons également que si la mention manuscrite était obligatoire, avant le 1er janvier 2022, pour les actes dont le bénéficiaire était un créancier, à compter du 1er janvier 2022, la mention est généralisée à tous les créanciers.
4.2.2 – Les accessoires
Avant 2022 : la mention devait préciser expressément que l’engagement couvrait le principal, les intérêts, et éventuellement les pénalités.
Depuis 2022 : l’article 2295 du Code civil prévoit que, sauf clause contraire, le cautionnement couvre :
les intérêts,
les accessoires de l’obligation garantie,
les frais de la première demande,
ainsi que les frais postérieurs à la dénonciation faite à la caution.
📊 Tableau comparatif – Étendue du cautionnement
| 🔹 Élément | Avant le 01/01/2022 | Depuis le 01/01/2022 |
|---|---|---|
| Capital garanti | Plafond obligatoire (mention manuscrite, art. L. 331-1 C. consom.) | Plafond obligatoire (art. 2297 C. civ.) exprimé en chiffres et en lettres |
| Intérêts et accessoires | Doivent figurer dans la mention (sinon limitation au seul principal) | Automatiquement inclus, sauf clause contraire (art. 2295 C. civ.) |
| Absence de plafond | Nullité du cautionnement | Nullité du cautionnement |
| Règle en cas de discordance | Non prévue | Les lettres priment sur les chiffres (art. 2297 C. civ.) |
✋ Points essentiels pour le juge consulaire
Vérifier que le plafond est bien mentionné dans tout cautionnement conclu par une personne physique.
Depuis 2022, l’absence de précision sur les accessoires n’entraîne plus la nullité : ils sont inclus par principe.
En cas de discordance entre chiffres et lettres → les lettres priment.
Attention : la règle du plafond s’applique également aux cautionnements donnés au profit de créanciers non professionnels depuis 2022.
5. – Durée du cautionnement
La durée de l’engagement de la caution est un élément déterminant : elle conditionne à la fois la sécurité juridique du créancier et la protection de la caution, personne physique.
L’ordonnance du 15 septembre 2021 (applicable depuis le 1er janvier 2022) a profondément modifié le régime : la mention de la durée n’est plus obligatoire dans l’acte.
📊 Tableau comparatif – Durée du cautionnement
| 🔹 Élément | 📅 Avant le 01/01/2022 | 📅 Depuis le 01/01/2022 |
|---|---|---|
| Durée obligatoire ? | Oui → la mention manuscrite devait préciser la durée de l’engagement, à peine de nullité (art. L. 331-1 C. consom.). | Non → l’article 2297 C. civ. ne l’impose plus. Le cautionnement peut être à durée indéterminée. |
| Validité des formules « ouvertes » | Jurisprudence : formule « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues » jugée valable (Cass. com., 15/11/2017, n° 16-10504). | Pas de formule imposée : la durée est déterminée par l’acte ou réputée indéterminée. |
| Expiration / Résiliation | L’engagement prend fin à l’expiration de la durée stipulée. Pas de résiliation unilatérale possible. | La caution peut résilier à tout moment (art. 2315 C. civ.), sous réserve d’un préavis contractuel ou, à défaut, d’un délai raisonnable. |
| Lien avec l’obligation principale | Suivait la durée prévue dans la mention manuscrite. | Suit la durée de l’obligation garantie (prêt, plan d’apurement). Si pas de terme fixé → durée indéterminée. |
✋ Points essentiels pour le juge consulaire
Avant 2022 : vérifier que la durée est indiquée dans la mention manuscrite (sinon nullité du cautionnement).
Depuis 2022 : la durée peut être indéterminée → importance de vérifier si une clause de résiliation est prévue.
En pratique, la durée suit toujours celle de l’obligation garantie :
prêt bancaire → durée fixe,
plan de redressement → durée du plan,
compte courant → durée indéterminée, résiliable par la caution.
6. – Distinction entre le cautionnement simple et le cautionnement solidaire
Le cautionnement peut être simple ou solidaire.
La distinction tient principalement aux droits dont dispose la caution lorsqu’elle est recherchée en paiement par le créancier.
6.1 – Le cautionnement simple : bénéfice de discussion et de division
Dans le cautionnement simple, la caution bénéficie de deux protections légales importantes :
📌 Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1 du Code civil) : la caution peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal, et n’être recherchée qu’en cas d’échec des poursuites.
📌 Le bénéfice de division (articles 2306, 2306-1 et 2306-2 du Code civil) : lorsqu’il y a plusieurs cautions simples, la caution poursuivie peut demander au créancier de diviser son action entre toutes les cautions solvables, chacune ne répondant que pour sa part.
6.1.1 – Exemple pratique du bénéfice de division
Situation : dette de 120.000 €, trois cautions simples de 120.000 € chacune.
Chaque caution ne peut être recherchée que pour 40.000 €.
Si l’une est insolvable, les deux autres devront 60.000 € chacune.
Autre situation : dette de 120.000 €, avec A = 40.000 €, B = 60.000 €, C = 60.000 €.
Répartition proportionnelle : A = 30.000 €, B = 45.000 €, C = 45.000 €.
Si B est insolvable, sa part (45.000 €) est répartie entre A et C au prorata, mais avec plafonds contractuels (A maximum 40.000 €, C maximum 60.000 €).
6.2 – Le cautionnement solidaire : exclusion des bénéfices
Dans le cautionnement solidaire, la caution ne peut bénéficier de discussion et de division.
🔹 Conséquence : le créancier peut réclamer directement à une seule caution le paiement de la totalité de la dette (dans la limite de son engagement), sans être obligé d’agir d’abord contre le débiteur principal ou de diviser ses poursuites entre les cautions.
6.2.1 – Fondement légal de cette exclusion
- Article 2305 du Code civil : pas de bénéfice de discussion pour la caution solidaire.
Article 2306, alinéa 3 du Code civil : pas de bénéfice de division en cas de solidarité.
Article 2297, alinéa 2 du Code civil : la mention doit constater que la caution reconnaît ne pas pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou divise ses poursuites (applicable avant et à compter du 1er janvier 2022).
6.2.2 – Recours après paiement
La caution solidaire qui a payé :
dispose d’un recours personnel contre le débiteur (article 2308),
bénéficie d’un recours subrogatoire dans les droits du créancier (article 2309),
peut agir contre ses co-cautions pour leur part contributive (article 2312).
6.2.3 – Exemple pratique 1 : trois cautions de 120.000 € chacune
| Situation | Cautionnement simple | Cautionnement solidaire |
|---|---|---|
| Dette : 120.000 € Trois cautions de 120.000 € chacune | – Chaque caution ne peut être poursuivie que pour 40.000 €. – Insolvabilité de l’une : les deux autres paient 60.000 € chacune. | – Le créancier peut réclamer 120.000 € à une seule caution. – Après paiement, cette caution récupère 40.000 € auprès de chacune des deux autres. |
6.2.4 – Exemple pratique 2 : cautions avec engagements différents
📊 Cautionnement simple / solidaire – Répartition de la dette
| Hypothèse | Données | Caution simple | Caution solidaire |
|---|---|---|---|
| 1. Dette garantie : 120.000 € A = 40.000 € B = 50.000 € C = 60.000 € | Total engagements = 150.000 € > dette | Calcul part contributive : A = 40.000 × 120.000 ÷ 150.000 = 32.000 € B = 50.000 × 120.000 ÷ 150.000 = 40.000 € C = 60.000 × 120.000 ÷ 150.000 = 48.000 € | Résultat identique : A = 32.000 € – B = 40.000 € – C = 48.000 €⚠️ Mais le créancier peut réclamer 60.000 € à C (plafond de son engagement), quitte à ce que C se retourne contre A et B. |
| 2. Même hypothèse avec B insolvable | Total engagements utilisables = 100.000 € | Nouveau calcul : A = 40.000 × 120.000 ÷ 100.000 = 48.000 € → limité à 40.000 € (plafond) C = 60.000 × 120.000 ÷ 100.000 = 72.000 € → limité à 60.000 € (plafond)👉 Total recouvrable = 100.000 €. | Résultat identique : A = 40.000 € – C = 60.000 €⚠️ Le créancier peut réclamer directement 60.000 € à C sans division. |
- La part contributive ne s’applique que lorsque le total des engagements des cautions dépasse la dette garantie.
- En pratique, le résultat financier est identique entre cautionnement simple et solidaire (pour une personne physique).
- La différence réside uniquement dans la procédure :
– simple → discussion et division
– solidaire → action directe contre une seule caution. - Historique :
– avant le 01/01/2022 → plafond obligatoire uniquement si le créancier était professionnel ;
– depuis le 01/01/2022 → plafond obligatoire pour tout cautionnement par une personne physique, quel que soit le créancier.
📊 Tableau comparatif – Cautionnement simple / Cautionnement solidaire
| 🔹 Élément | Cautionnement simple | Cautionnement solidaire |
|---|---|---|
| Bénéfice de discussion | Oui, la caution peut exiger la poursuite préalable du débiteur. | Non, le créancier peut agir directement contre la caution. |
| Bénéfice de division | Oui, la dette est répartie entre toutes les cautions. | Non, le créancier peut réclamer le tout à une seule caution. |
| Solidarité | Ne se présume pas, doit être prévue. | Doit être stipulée et constatée dans la mention. |
| Recours entre cautions | Proportionnel aux parts garanties. | Identique, mais après paiement intégral par une seule caution. |
✋ Points essentiels pour le juge consulaire
Vérifier si la solidarité est expressément stipulée (elle ne se présume jamais).
Contrôler la mention prévue par l’article 2297 du Code civil : la renonciation aux bénéfices doit être clairement constatée.
L’absence ou l’irrégularité de la mention de solidarité ne rend pas le cautionnement nul, mais le transforme en cautionnement simple.
En cas de pluralité de cautions, rappeler que la solidarité ne modifie que la poursuite par le créancier : la répartition finale de la charge reste proportionnelle aux engagements.
📑 7. – Le sous-cautionnement
Le sous-cautionnement est un mécanisme de garantie de la garantie : une personne (sous-caution) s’engage non pas envers le créancier, mais envers la caution principale, à lui rembourser ce qu’elle aura payé au créancier.
Article 2291-1 du Code civil : « Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que lui devra le débiteur à raison du cautionnement. »
📊 Tableau comparatif – Sous-cautionnement avant / après 01/01/2022
| Élément | Avant le 01/01/2022 | Depuis le 01/01/2022 |
|---|---|---|
| Existence | Création prétorienne (jurisprudence, pratique bancaire) | Codification officielle (article 2291-1 du Code civil) |
| Rapport juridique | Pas de lien direct entre sous-caution et créancier | Identique : la sous-caution n’est tenue qu’envers la caution principale |
| Conditions d’action | La caution devait avoir payé et échoué à se retourner contre le débiteur | Idem, sur le fondement des articles 2308 et 2309 du Code civil |
| Formalisme | Règles du cautionnement classique (mention manuscrite/plafond si créancier professionnel) | Plafond obligatoire (article 2297 du Code civil) en chiffres et en lettres, sauf acte notarié ou d’avocat |
| Devoir de mise en garde (sous-caution) | Aucune obligation du créancier envers la sous-caution (solution jurisprudentielle constante avant 2022). | Aucun changement : aucun texte n’impose un devoir de mise en garde du créancier envers la sous-caution. |
| Information de la sous-caution | Pas de régime légal : pas d’information annuelle ni d’information du premier incident imposées à la charge de la caution principale. | Oui : la caution principale doit, dans le mois, transmettre à la sous-caution les informations qu’elle reçoit au titre de l’information annuelle (article 2302 du Code civil) et de l’information du premier incident de paiement (article 2303), conformément à l’article 2304. Aucune obligation directe du créancier envers la sous-caution. |
| Disproportion | Application de l’ancien article L. 332-1 (caution personne physique / créancier professionnel) | Application de l’article 2300 du Code civil : toute caution personne physique peut invoquer la disproportion |
⚖️ Points essentiels pour le juge consulaire
- Le sous-cautionnement est autonome : la sous-caution n’est pas tenue envers le créancier, mais uniquement envers la caution principale.
- Action de la caution contre la sous-caution seulement si : (1) la caution a payé le créancier ; (2) le recours contre le débiteur principal est resté infructueux.
- Depuis 2022, plafond obligatoire en chiffres et en lettres (art. 2297 C. civ.) ; à défaut, nullité relative invocable par la sous-caution.
- La sous-caution bénéficie des mêmes protections qu’une caution personne physique (notamment la disproportion – art. 2300 C. civ.).
- Obligation d’information : la caution principale doit informer sa sous-caution (information annuelle reçue – art. 2302 ; premier incident de paiement – art. 2303).
8. – Le cautionnement au regard de la situation patrimoniale de la caution
Le cautionnement n’est pas réservé à certaines personnes : toute personne juridiquement capable peut s’engager.
Cependant, la situation patrimoniale de la caution influence directement l’étendue du gage du créancier.
Le législateur a donc prévu des règles spécifiques, en particulier pour les époux mariés et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS).
📊 Tableau comparatif – Effets patrimoniaux selon la situation de la caution
| Situation de la caution | Effets juridiques |
|---|---|
| Époux mariés sous communauté |
|
| Époux séparés de biens | Chaque époux n’engage que son patrimoine propre. Le créancier ne peut agir que contre l’époux caution. |
| Partenaires pacsés |
|
⚖️ Points essentiels pour le juge consulaire
- 📌 Vérifier le régime matrimonial ou de PACS pour déterminer l’étendue du gage du créancier.
- ⚠️ Le consentement du conjoint doit être exprès : il ne peut résulter d’une simple signature à proximité de l’acte.
- 🔎 En communauté, le créancier ne peut poursuivre les biens communs que si le conjoint a donné son accord.
- 👥 En PACS, le principe est la séparation de biens → seul le patrimoine du signataire caution est engagé.
- 🖊️ La jurisprudence impose une vigilance particulière en cas d’ambiguïté : toujours rechercher si le conjoint ou le partenaire a effectivement consenti à l’engagement.